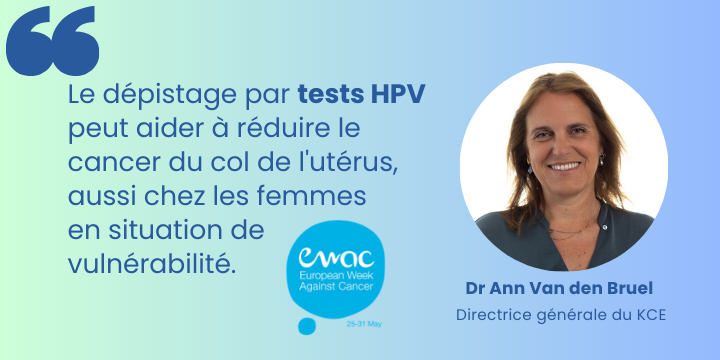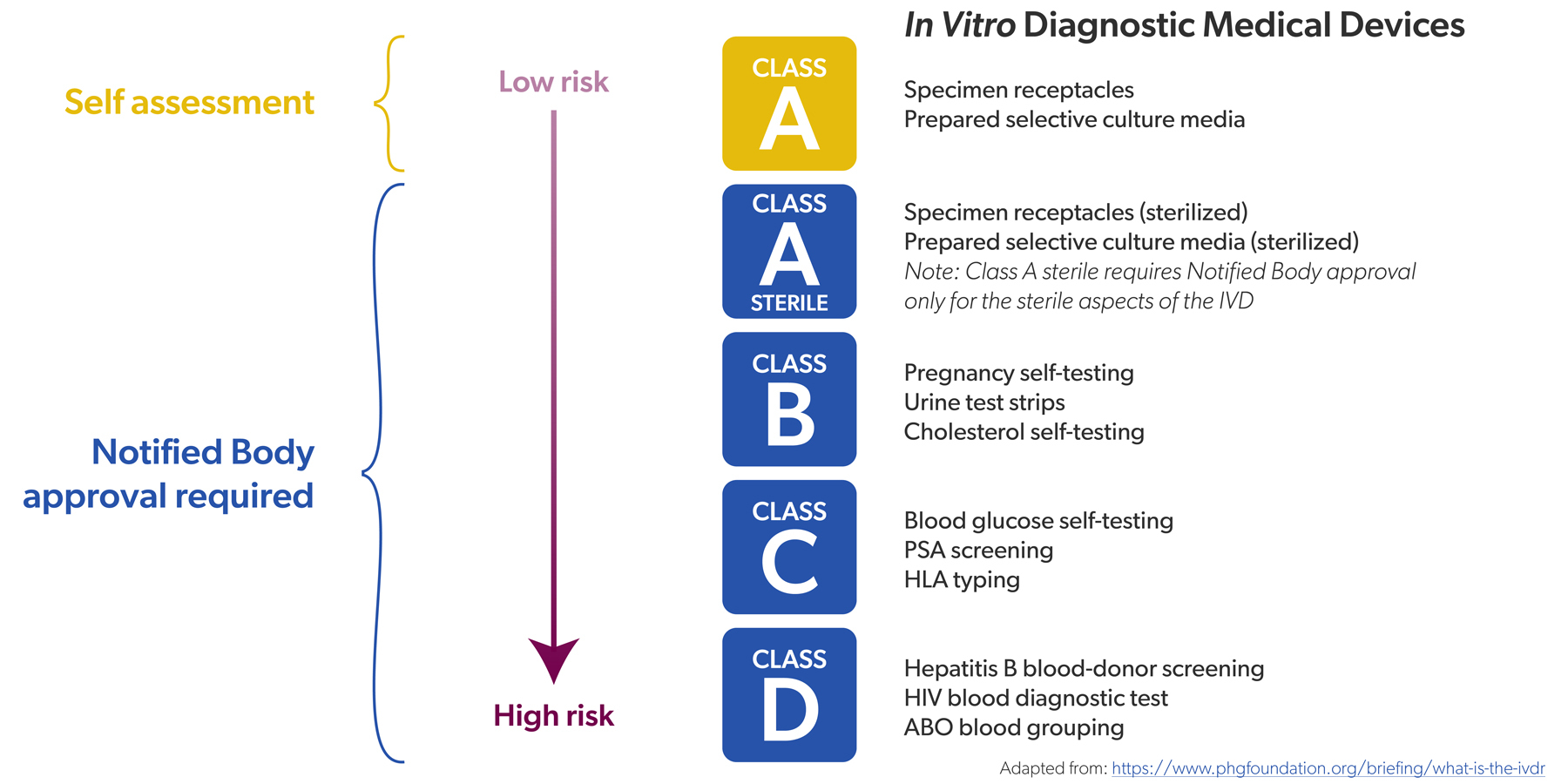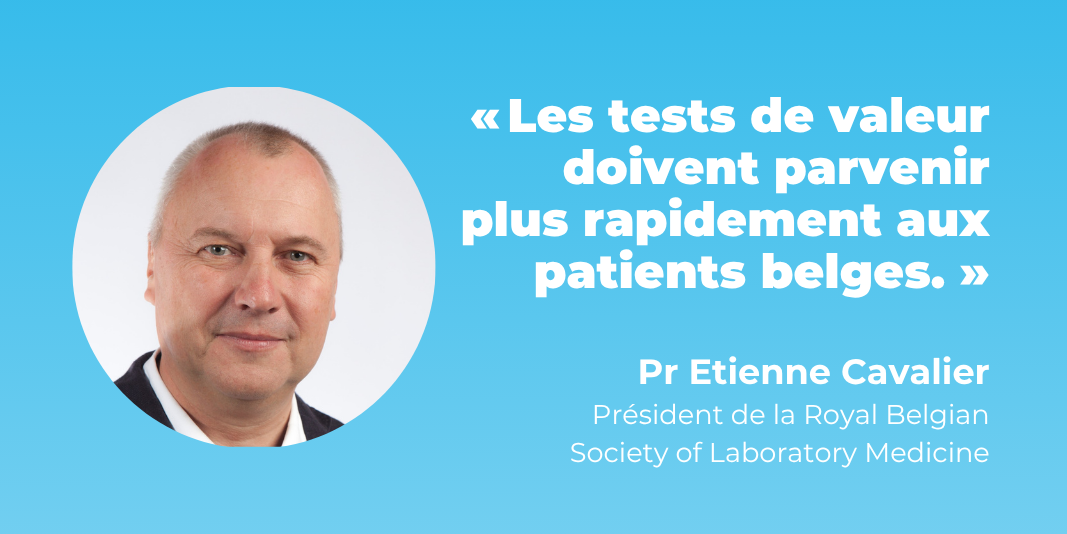Un diagnostic précoce du cancer est crucial pour réduire l’impact de la maladie sur le patient, son entourage et la société. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a fait passer ce message sans détour en 2017, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer.
Les DIV et le dépistage
Le dépistage est essentiel au diagnostic précoce. Il repose notamment sur les diagnostics in vitro (DIV). Une publication de l’OMS sur la gestion du cancer répertorie une série de tests de diagnostic in vitro prioritaires pour des programmes de dépistage efficaces.
On n’exploite, hélas, pas suffisamment le potentiel des DIV à l’heure actuelle, estime MedTech Europe dans son rapport intitulé The Value of Diagnostic Information in Cancer Care, publié en 2022.
Il est parfois question de force majeure. Prenons l’exemple de la baisse de 40 % du nombre de diagnostics de cancer en Belgique entre 2019 et 2022. Elle s’explique par le report des soins (comme les programmes de dépistage) en raison de la pandémie de coronavirus.
Cancer du col de l’utérus
Dans d’autres cas, la cause se trouve ailleurs, par exemple dans la politique (ou l’absence de politique). MedTech Europe cite l’exemple du cancer du col de l’utérus. Les chances de survie des patientes sont très élevées (92 %) en cas de dépistage précoce. Le taux de survie à 5 ans tombe à 58 % en présence de métastases dans les organes et tissus voisins et à 18 % en cas de métastases dans d’autres parties du corps. D’où l’importance de procéder à un dépistage régulier, qui reste néanmoins trop rare.
Les chances de survie des patientes atteintes d’un cancer du col de l’utérus sont très élevées en cas de dépistage précoce, mais il est encore trop peu pratiqué.
Le type de test joue également un rôle. Le dépistage primaire reposait généralement sur un frottis cervical qu’on analysait en laboratoire pour identifier d’éventuelles anomalies cellulaires (examen cytologique). Avec le test de dépistage du papillomavirus humain (HPV), on dispose désormais d’un test moléculaire : au lieu d’étudier les anomalies cellulaires, ce test cherche la présence du HPV, puisqu’il existe un lien étroit entre ce virus et le cancer du col de l’utérus.
Le test de dépistage du HPV devrait permettre de détecter et donc de traiter davantage de cancers du col de l’utérus à un stade précoce, ce qui se traduirait par un meilleur pronostic pour la patiente. Mais ce test est loin d’être utilisé partout en Europe.
KCE : « L’objectif de 85 % de couverture du dépistage n’a pas été atteint en 2021 »
Le dépistage du cancer du col de l’utérus en Belgique peut et doit être amélioré, selon un rapport du Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE), paru en 2024.
Dr Ann Van den Bruel, directrice générale du KCE : « L’objectif de 85 % pour le dépistage du cancer du col de l’utérus n’a pas été atteint en 2021. À peine 57 % des personnes cibles se sont fait dépister. Ce pourcentage était encore plus faible chez les femmes ayant droit à un remboursement majoré. La vaccination contre le HPV, le dépistage avec test HPV et la possibilité d’autotest peuvent contribuer à réduire davantage le cancer du col de l’utérus dans tous les groupes, y compris ceux qui sont vulnérables sur le plan socio-économique. »
Au sein de l’UE, seules la Suède, la République tchèque, l’Irlande, la Finlande et la Slovénie ont atteint des taux de couverture acceptables (70 %). Sur une note positive, la Belgique a récemment décidé de dépister tous les cinq ans les femmes âgées de 30 à 64 ans au moyen du test moléculaire du papillomavirus.
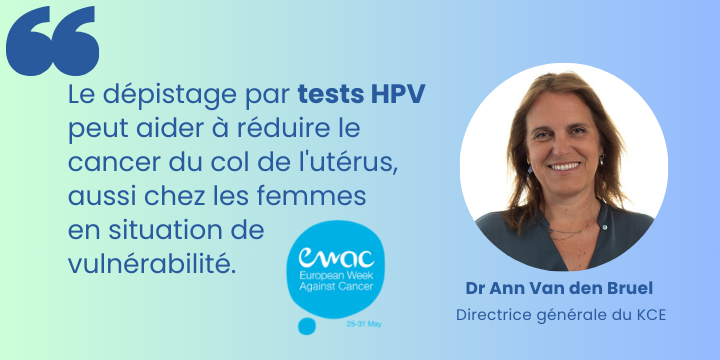
Pronostic moins favorable
Que le diagnostic tardif soit dû à un cas de force majeure ou non, les conséquences pour le patient sont les mêmes : comme le traitement ne peut être entamé que plus tard, l’efficacité de la thérapie, les chances de guérison, la qualité de vie s’en trouvent compromises.
MedTech Europe appelle donc les décideurs politiques européens à investir encore davantage dans des initiatives ciblées en matière de dépistage et de détection précoce du cancer. Dans l’intérêt des patients et de leurs familles, mais aussi dans celui des soins et de la société.
Quand le cancer est diagnostiqué à un stade précoce, le traitement coûte deux à quatre fois moins cher qu’en cas de diagnostic à un stade plus avancé.
Quand le cancer est diagnostiqué à un stade précoce, le traitement coûte, en effet, deux à quatre fois moins cher qu’en cas de diagnostic à un stade plus avancé. Sans compter les coûts indirects tels que la perte de productivité économique (du patient et des aidants proches).
Le continuum complet de soins du cancer
Le rôle des DIV dans le traitement du cancer ne se limite d’ailleurs pas au dépistage. Selon MedTech Europe, les DIV sont indispensables du début à la fin du continuum des soins : de la prévention au suivi de l’évolution de la maladie, en passant par le dépistage, la détection précoce, le diagnostic et (le choix de) la thérapie.
(lisez la suite sous l'image)

L’organisation faîtière européenne étaye son propos par une série d’exemples autres que le dépistage du cancer du col de l’utérus : diagnostics in vitro dans le cadre d’un cancer du sein, tests de mutation génétique au moment de choisir la bonne thérapie ciblée pour traiter le cancer colorectal métastatique, biopsies liquides pour surveiller l’effet du traitement du cancer du poumon.
MedTech Europe conclut en adressant cinq recommandations concrètes aux décideurs politiques européens, lesquelles sont aussi hautement pertinentes dans le contexte belge :
- renforcer les lignes directrices, les infrastructures et les programmes nationaux de dépistage et de détection précoce ;
- réduire les inégalités face au cancer, par exemple les différences au niveau du délai de diagnostic entre les groupes, dans la participation aux programmes de dépistage, etc. ;
- améliorer l’accès des patients aux outils de diagnostic innovants, notamment via un remboursement ponctuel des DIV de grande valeur ;
- moderniser l’évaluation des DIV, avec une plus grande attention portée à leur impact sur l’économie de la santé à tous les stades du continuum des soins du cancer ;
- préparer les systèmes de soins de santé aux futures crises sanitaires afin d’assurer la continuité des soins prodigués aux personnes atteintes d’un cancer à tout moment.
Europe’s Beating Cancer Plan
Si l’Europe n’abrite qu’environ un dixième de la population mondiale, elle représente un quart des cas de cancer à l’échelle internationale. À l’heure actuelle, 20 % des décès en Europe sont dus au cancer. En 2035, le cancer sera la première cause de décès sur le continent. Et la liste des prévisions de ce genre est encore longue…
Ces chiffres s’expliquent : le cancer est une « maladie de vieillesse » et l’Europe est actuellement le continent dont la population est la plus âgée. Mais nous devons aussi y voir un signal d’alarme : l’investissement dans le traitement du cancer devrait être une priorité européenne. D’une part, pour permettre aux personnes atteintes d’un cancer de vivre le plus longtemps possible en gardant la meilleure qualité de vie possible et, d’autre part, pour prévenir autant que possible l’apparition de nouveaux cas.
C’est la raison pour laquelle l’Union européenne a lancé le Europe’s Beating Cancer Plan (EBCP) en 2021. Cette initiative européenne pour vaincre le cancer est un plan ambitieux assorti des budgets nécessaires pour concrétiser ces ambitions.
Déploiement en Belgique
Le Centre du Cancer de Sciensano coordonne la mise en œuvre des plans européens en Belgique. Ce déploiement s’effectue par l’intermédiaire du Belgian EBCP Mirror Group, qui comporte sept groupes de travail thématiques autour de sept domaines clés des soins du cancer.
Les personnes qui souhaitent en savoir plus sur les activités du groupe et/ou rejoindre un ou plusieurs groupes de travail thématiques peuvent consulter le site web www.beatingcancer.be.