Actualités et publications
Grâce à notre salle de presse, nous partageons régulièrement des mises à jour sur les technologies médicales, les évolutions politiques pertinentes et des publications intéressantes. Vous restez ainsi informé d’un secteur en constante évolution.

« Nouveau trajet de soins pour l’insuffisance cardiaque marque une étape importante pour la m-health en Belgique »
Dès le 1er janvier 2025, les hôpitaux belges seront remboursés pour la télésurveillance des patients souffrant d’insuffisance cardiaque chronique. Le Comité de l’assurance de l'Inami a approuvé la nouvelle convention le mois dernier. L'accord marque « une étape importante », estime Steven Vandeput (beMedTech).
Notre fédération s’efforce, depuis des années déjà, d’ancrer l’utilisation des technologies médicales numériques dans les processus de soins en Belgique, notamment en prônant un financement structurel.
Le tout premier trajet de soins qui prévoit le remboursement de la télésurveillance peut donc incontestablement être qualifié de percée historique, estime Steven Vandeput. Conseiller en santé numérique pour beMedTech, il a participé de près aux préparatifs du nouveau trajet de soins pour l’insuffisance cardiaque.
Intervention proactive
« Le choix de l’insuffisance cardiaque chronique n’est pas le fruit du hasard », souligne-t-il. « On estime que 2 à 3 % de la population belge en souffre, avec 40 nouveaux diagnostics posés chaque jour. Outre son impact considérable sur la qualité de vie des patients, cette pathologie pèse lourdement sur le budget des soins de santé, avec près de 300 millions d’euros de dépenses annuelles. »
« L’insuffisance cardiaque chronique a un impact considérable sur la qualité de vie des patients et pèse lourdement sur les dépenses de santé. »
« En utilisant la technologie médicale numérique, les équipes soignantes de l’hôpital peuvent surveiller les patients à distance et intervenir si les données révèlent l’imminence d’un épisode d’insuffisance cardiaque. À la clé ? Des soins plus efficaces et une meilleure qualité de vie pour les patients. »

Tout bénéfice pour le système
Steven Vandeput y voit aussi un énorme potentiel pour le système des soins de santé.
« Un projet mené aux Cliniques de l’Europe révèle que la télésurveillance de l’insuffisance cardiaque réduit les hospitalisations de 15 % et la mortalité de 16 %. Extrapolé au niveau national, un tel résultat permettrait à l’assurance santé de réduire ses dépenses de 28,7 millions d’euros par an. »
« Cela dit, intégrer la télésurveillance dans les processus de soins engendre certes un coût d’investissement, mais il reste bien inférieur. Conséquence : le secteur de la santé pourra, à terme, en faire davantage avec des moyens identiques. »
« Les gains d’efficacité ne se concrétiseront pas comme par enchantement. »
« Mais ces gains d’efficacité ne se concrétiseront pas comme par enchantement », prévient-il. « Nous devons repenser les processus de soins pour soutenir l’utilisation des technologies médicales adéquates. Et nous devons recueillir les bonnes données au fur et à mesure, afin de pouvoir évaluer correctement l’efficacité de ces nouveaux processus. Nous n’y parviendrons que si nous collaborons avec l’ensemble des acteurs concernés. »
Autres maladies chroniques
Vandeput espère que la nouvelle convention n’est qu’un début. « Tout le monde a pris conscience de la valeur ajoutée des soins assistés par le numérique, y compris le gouvernement. C’est ce qui ressort clairement de la campagne “Digital-In-Health” que l'Inami a lancée dans la presse médicale en début d’année, avec notre concours et celui d’Agoria. »
« En l’absence de financement, aucune avancée n’a encore été réalisée sur le terrain. Espérons que ce nouveau trajet de soins contribuera à faire bouger les choses. Nous pourrions déployer la télésurveillance dans le cadre de nombreux autres trajets de soins : diabète, cancer, apnée du sommeil… »
Équipe de télésurveillance à l’hôpital
Seuls les hôpitaux qui remplissent les conditions requises peuvent adhérer au nouveau trajet de soins et se voir rembourser la télésurveillance des patients qui souffrent d’insuffisance cardiaque chronique. Ils doivent notamment disposer d’une équipe de télésurveillance chargée d’examiner les données recueillies auprès des patients.
Composée au minimum d’un cardiologue et d’un infirmier spécialisé, l’équipe doit travailler en étroite collaboration avec le médecin généraliste qui gère le dossier médical global du patient, afin d’assurer une continuité maximale des soins.
Vous trouverez de plus amples informations sur le site web de l'Inami

La télésurveillance et le traitement de l’apnée sont aujourd’hui indissociables
Même si la technique est récente, le Dr Vincent Hers, chef du service de pneumologie au CHR Sambre et Meuse (site Meuse), a déjà du mal à imaginer la prise en charge des patients atteints d’apnée du sommeil sans suivi à distance. « Et nous devrons nous appuyer davantage encore sur les soins hybrides », affirme-t-il. « Le syndrome d'apnées-hypopnées liées au sommeil concerne selon les études 5 à 20 % de la population. Il est tout simplement impossible de suivre autant de personnes de manière traditionnelle. »
Depuis trente ans, le Dr Vincent Hers, pneumologue, prend en charge les patients souffrant d'un syndrome d'apnées hypopnées obstructives du sommeil ou SAHOS (voir encadré).
Obstructive et centrale
On estime qu’un demi-million de Belges souffrent du syndrome d’apnée du sommeil. Pendant leur sommeil, ils arrêtent de respirer complètement ou partiellement à plusieurs reprises pendant au moins 10 secondes. Un tel arrêt respiratoire peut toucher tout le monde, mais on parle d’apnée du sommeil à partir de 5 interruptions par heure.
Les apnées trouvent généralement leur origine dans une obstruction des voies respiratoires supérieures (syndrome d’apnées-hypopnées obstructives du sommeil ou SAHOS). La cause réside parfois aussi dans le fait que le cerveau ne contrôle pas correctement la respiration (syndrome d’apnée centrale du sommeil ou SACS). Le SACS peut être concomitant au SAHOS.
Dr Hers, quels sont les effets du SAHOS sur l’être humain ?
« Pendant le sommeil, les muscles de la gorge se relâchent. Chez certaines personnes, cela peut bloquer les voies respiratoires, empêchant l'air de passer. Ces blocages partiels (hypopnées) ou complets (apnées) augmentent l’effort respiratoire durant les sommeil. »
« Les personnes qui souffrent d’apnée ou d'hypopnées du sommeil ronflent souvent de manière bruyante et irrégulière. Lorsque la respiration est entravée, la personne concernée se réveille très brièvement, ce qui relance la respiration. »
« La personne elle-même n’est pas nécessairement consciente de ses ronflements et des micro-éveils, c’est souvent le conjoint qui remarque les premiers signaux. »
« Le gros problème de l’apnée du sommeil est que la qualité du sommeil s’en ressent. Et cela peut entraîner un large éventail de problèmes de santé. »
« Le gros problème est que la qualité du sommeil s’en ressent. Le sommeil n’est pas suffisamment réparateur, les gens se sentent fatigués ou somnolents pendant la journée. Ils ont plus de maux de tête, ou des difficultés pour se concentrer. Certains ont des troubles de l’humeur ou des troubles de l’érection. Un mauvais sommeil prolongé peut également entraîner une élévation de la tension artérielle et des arythmies cardiaques. »
L’apnée obstructive du sommeil est très fréquente. Pouvez-vous décrire le « patient typique » ?
« Le SAHOS est une pathologie dont le phénotype (l’ensemble des caractéristiques observables chez un patient, NDLR) est très diversifié : il concerne de manière caricaturale, l’homme d’âge moyen en surpoids mais aussi la jeune femme dont la mâchoire inférieure est trop petite. »
« Certains traits physiques favorisent les apnées, comme un cou large ou court, une mâchoire inférieure petite ou en retrait, des amygdales ou des adénoïdes hypertrophiées (souvent chez les enfants). S’y ajoutent des facteurs aggravants comme le tabagisme, l’alcool, les médicaments ou la position de sommeil. Cela se traduit par des profils de patients très divers. »
« En chiffres absolus, plus d’hommes que de femmes sont atteints de SAHOS, mais la répartition s’équilibre au delà de 50 ans. Chez les femmes, le SAHOS survient souvent après la ménopause. »

Comment traiter ce syndrome ?
« Il existe un certain nombre d’options thérapeutiques, qui poursuivent toutes le même objectif : éliminer l’obstruction à la respiration pendant le sommeil. Qu’elle soit due à une faiblesse musculaire, à une mauvaise position de la mâchoire inférieure ou à d'autres causes. »
« Il convient souvent d'améliorer l’hygiène de vie, notamment en s’abstenant de fumer ou en limitant sa consommation d’alcool. En cas d’obésité ou de surcharge pondérale, des mesures spécifiques doivent également être prises. »
« Les options thérapeutiques poursuivent toutes le même objectif : éliminer l’obstruction à la respiration pendant le sommeil. »
« Bon nombre de patients sont traités par CPAP (continuous positive airway pressure, NDLR). Ce dispositif consiste en une turbine qui génère un débit d'air qui est délivré via un masque nasal dans les voies aériennes supérieures. Ce débit produit une pression qui maintient ces voies ouvertes, agissant comme un coussin d'air empêchant le 'tuyau' de se fermer. »
« En cas de symptômes limités, le port d’un dispositif buccal spécifique pendant le sommeil peut être une option. Une telle orthèse positionne la mâchoire inférieure en avant, ce qui maintient le pharynx ouvert. Si le patient présente une dysmorphie, on opte parfois pour une intervention chirurgicale. Mais il s’agit d’une opération dont l’indication doit être bien posée et qui demande souvent une longue préparation orthodontique préalable. »
« De nos jours, nous utilisons toujours la technologie numérique pour surveiller le patient à distance. »
Pouvez-vous nous parler un peu plus de la télésurveillance dans le cadre d’un traitement par CPAP (appareil de pression positive)? Qu’est-ce qui justifie ce choix ?
« La plupart des appareils de pression positive sont équipés d’un système de télésurveillance permettant d’accompagner le patient à distance au cours de son traitement. »
« Les premières semaines de traitement sont cruciales pour une bonne adhérence. En gardant le contact avec le patient en cas de difficulté, la télésurveillance permet d’éviter un bon nombre d’abandons précoces de la thérapeutique. Le patient, qui sait que l’équipe soignante peut suivre son traitement à distance, s’en trouve rassuré. Cette approche permet aussi de gagner du temps. Nous pouvons, par exemple, régler les paramètres de l’appareil depuis l’hôpital et éviter au patient des déplacement inutiles. »
« Tous les patients peuvent également associer leur appareil CPAP à une application sur leur téléphone. Celle-ci leur donne un meilleur aperçu de leur traitement : ils peuvent obtenir des données objectives sur l’évolution de la qualité de leur sommeil, voir s’il y a des apnées résiduelles ou s’il y a des fuites à travers le masque... Tout cela permet une personnalisation et un meilleur auto-contrôle impliquant les patients dans leur thérapeutique. »
Arnaud (patient) : « Une motivation supplémentaire pour suivre la thérapie »
Arnaud Sprimont est sculpteur et créateur de bijoux. À la mi-mai de cette année, le CHR Sambre et Meuse lui a prescrit un traitement par CPAP, y compris un suivi à distance. Jusqu’à présent, son expérience est plus que positive.
« Je suis naturellement très intéressé par ma propre santé et prêt à lui consacrer beaucoup d’efforts. L’application myAir m’y aide », explique-t-il. « Voir dans l’application votre nombre d’apnées diminuer régulièrement vous motive encore plus à suivre correctement le traitement par CPAP. Au cours des derniers mois, par exemple, je suis passé de 14 à 0,2 apnée par heure pendant la nuit. »
« Ces progrès se traduisent par une attitude plus positive. Un exemple ? J’ai commencé à nager, mais je trouvais toujours une raison d’abandonner : j’étais fatigué, je n’en avais pas envie, je n’avais pas le temps... Je n’avais ni la motivation ni l’énergie nécessaire pour en faire une habitude. Aujourd’hui, c’est chose faite. Après un mois de thérapie CPAP, j’ai repris la natation et je vais maintenant à la piscine trois fois par semaine. Tout est différent : j’ai envie, je suis enthousiaste et je sens que c’est possible. »

L’équipe soignante y trouve également son compte.
« Absolument. Grâce à la télésurveillance, nous sommes en mesure d’identifier à distance les problèmes que pourrait rencontrer un patient. C’est particulièrement important au début d’une thérapie CPAP. Dormir avec un masque, surtout au début, peut être un peu gênant. Il est donc essentiel de bien suivre le patient au cours des premières semaines. Si nécessaire, nous le rappelons à l’hôpital pour ajuster le réglage du masque ou pour le sensibiliser davantage à l’importance de l’observance. »
« Avant que nous puissions surveiller les patients à distance, de nombreux appareils CPAP se perdaient dans les armoires des patients. »
« Nous avions l’habitude de n’entendre parler de problèmes que lorsque le patient venait en personne pour une consultation. Tous les patients n’appellent pas l’hôpital en cas de souci. Résultat : de nombreux appareils de PPC se perdaient dans les armoires des patients pour y prendre la poussière jusqu’à la prochaine consultation. Le patient et nous-mêmes perdions ainsi un temps précieux et la sécurité sociale payait pour des appareils coûteux qui n’étaient pas utilisés. »
Y a-t-il des patients CPAP que vous ne suivez pas à distance ?
« Non, toutes les personnes à qui nous prescrivons la CPAP peuvent être suivies à distance. Parce que les avantages sont indéniables et parce que, d’un point de vue pratique, nous ne pouvons plus faire autrement. Il y a tout simplement trop peu de prestataires de soins de santé pour assurer le suivi 'traditionnel' de tous les patients qui bénéficient d’un traitement CPAP. Cela vaut pour tous les hôpitaux, pas seulement pour le nôtre. »
« Le soutien administratif que nous apporte l’application est également d’une grande aide à cet égard. Nous sommes tenus d’établir des rapports réguliers pour l’INAMI sur les traitements par CPAP - la première fois au bout de 3 mois, puis tous les ans. Grâce au logiciel, nous pouvons désormais le faire sans que chaque patient doive nécessairement venir à l’hôpital avec son appareil. Cela représente un gain de temps considérable, du temps que nous pouvons utiliser à bon escient. »
Pas (encore) de remboursement structurel
La télésurveillance des patients qui souffrent d’apnée du sommeil et reçoivent un traitement par CPAP n’est actuellement pas remboursée en Belgique, mais Jean-Luc Pirlot de ResMed espère que la donne changera bientôt.
« Malgré l’absence de remboursement, de plus en plus d’hôpitaux déploient la télésurveillance en raison de sa plus-value évidente », affirme-t-il. « Il y a également de grandes chances que la télésurveillance fasse partie de la nouvelle convention pour le traitement du SAHOS qui est en cours d’examen. »
« Avec ResMed, nous pensons déjà à la suite. Nous voulons intégrer notre solution aux dossiers médicaux électroniques des hôpitaux afin que l’équipe soignante puisse la mettre en œuvre en un minimum d’étapes. Et nous voulons qu’à l’avenir, les prestataires de soins de santé puissent recueillir les commentaires et les expériences des patients concernant leur traitement par l’intermédiaire du système pour pouvoir intervenir si nécessaire. »

Rethinking diabetes care: d’un événement éclairant à des idées lumineuses?
Comment faire en sorte que les patients atteints de diabète bénéficient pleinement des avancées technologiques ? Telle était la question au centre de l’événement " Rethinking diabetes care: from innovation to new care models " que nous avons organisé le 15 octobre, en collaboration avec E-Health Venture.
Glucomètres, pompes à insuline, technologies de capteurs, apps médicales, outils de télésurveillance… : d’innombrables technologies médicales peuvent contribuer à améliorer la prise en charge du diabète. Mais les outils technologiques seuls ne suffisent pas. Pour exploiter pleinement leur potentiel, nous devons les intégrer dans des modèles de soins adaptés.
Comment mettre en place ce type de nouveau modèle de soins ? " En réunissant les différents acteurs des soins aux personnes diabétiques, en essayant de comprendre encore mieux le point de vue de chacun, puis en élaborant conjointement une nouvelle approche ", a souligné Sabrina Suetens, Managing Director de beMedTech. " Nous sommes donc ravis d’avoir organisé avec E-Health Venture cet événement qui a rassemblé de multiples intervenants. "
Au-delà du diabète
"Ce que nous faisons aujourd’hui va d’ailleurs bien au-delà de la prise en charge du diabète ", poursuit notre Managing Director. " Le nombre de personnes atteintes de maladies chroniques augmente fortement alors que le nombre de prestataires de soins stagne. Nous avons urgemment besoin de solutions qui permettent d’organiser davantage de soins chroniques, et de préférence des soins de meilleure qualité, avec le même nombre de soignants. Cela nécessite de développer des produits innovants, d’optimiser les processus et d’utiliser les données de santé plus efficacement. "
'Pour la plupart des start-up, le plus grand obstacle à l’heure actuelle réside dans le passage de l’innovation à l’adoption et à l’intégration effectives dans les systèmes de soins de santé. '
Erlend Debast, CEO d’E-Health Venture, incubateur dans le domaine de la santé numérique, est tout à fait d’accord. L’entreprise basée à Anderlecht se concentre sur la " période post-pilote ". "Pour la plupart des start-up, le plus grand obstacle à l’heure actuelle réside dans le passage de l’innovation à l’adoption et à l’intégration effectives dans les systèmes de soins de santé ", explique-t-il. " Une entreprise ne peut pas à elle seule forcer ce genre de percée. Il s’agit de créer une valeur commune bottom-up en collaboration avec les patients, le personnel et les établissements de soins. "
Moins de 50% des patients sont connus
Le Prof. Dr Frank Nobels (hôpital Onze-Lieve-Vrouw à Alost et KU Leuven) a partagé son rêve d’un registre national des données sur le diabète. " Une politique solidement étayée, l’amélioration de la qualité des soins, les applications cliniques et de recherche ainsi que l’autonomisation des patients reposent sur des données de qualité ", estime Frank Nobels. " Nous disposons actuellement de nombreuses sources de données en Belgique, mais elles ne sont pas ou pas suffisamment reliées entre elles. "
Avec le Nationella Diabetes Registret et le programme Diabetes Audit and Research Tayside, la Suède et l’Écosse démontrent ce qu’il est possible de faire quand on combine intelligemment les données. Frank Nobels : "Ces pays ont une idée plus précise des causes et des conséquences du diabète et de l’impact des soins, ce qui leur permet d’intervenir de manière plus ciblée. "
'Une requête dans les DPI nous permet d’identifier les patients qui sont vraisemblablement diabétiques, après quoi le médecin généraliste peut procéder à des contrôles ciblés. '
Ce genre d’initiative est aussi possible en Belgique. " Plusieurs initiatives prometteuses sont en cours en matière de données. Mais les données sources doivent être de bonne qualité, et c’est là que le bât blesse trop souvent. Nous connaissons actuellement moins de 50 % des personnes atteintes de diabète ", explique Frank Nobels.
" Comment résoudre ce problème ? En lançant, par exemple, une requête dans les DPI pour identifier les patients vraisemblablement diabétiques, puis en demandant aux médecins généralistes de confirmer ou d’infirmer officiellement le diagnostic. "
(Suite de l’article sous l’encadré)
Pitchs : de la prévention et des pharmaciens à la photonique et à l’IA
Cinq entreprises ont pu présenter leur solution au public, qui jouait le rôle de jury. Une note accordée sur la base de quatre critères (*) a permis d’établir le classement suivant :
- OneTwo Analytics: Entreprise suédoise fondée en 2019. Elle utilise des modèles entraînés par l’IA pour interpréter les données de mesure du glucose en continu (CGM). Les prestataires de soins peuvent consulter les données et leur interprétation dans un rapport tandis que les patients reçoivent un feed-back quotidien via une app.
- moveUP: Entreprise belge fondée en 2015. Elle offre aux patients diabétiques et aux prestataires de soins un aperçu en temps réel des paramètres pertinents, et déclenche une alarme quand des valeurs nécessitent une attention particulière. Elle mise sur l’interopérabilité avec les logiciels des hôpitaux et des médecins généralistes.
- Greenhabit: Entreprise néerlandaise fondée en 2018. Elle se concentre sur la prévention du diabète de type 2. Elle utilise la thérapie cognitivo-comportementale en ligne pour identifier les causes des comportements nocifs pour la santé et les traiter progressivement dans le cadre d’une approche intégrée.
- Indigo: Entreprise belge fondée en 2016, en tant que spin-off de l’UGent et de l’imec. Elle met au point un capteur capable de mesurer et de surveiller différents biomarqueurs (glycémie, cétones, lactate…) grâce à la technologie photonique. Le capteur serait implanté en sous-cutané.
- Salvus: Entreprise belge fondée en 2020. Elle élabore une plateforme qui permet aux pharmaciens d’accompagner les patients de manière proactive. Ceux-ci peuvent passer un test qui prédit le risque de diabète. Les pharmaciens peuvent ainsi suivre activement les personnes qui présentent un risque accru.
(*) Besoin réel, faisabilité de la mise en œuvre, évolutivité, soutien aux patients et/ou aux prestataires de soins.
CGM et diabète de type 2
Le Prof. Dr Laurent Crenier (Hôpital Erasme et H.U.B.) s’est penché sur le suivi du glucose en continu, ou CGM (continuous glucose monitoring). Les avantages pour les patients atteints de diabète de type 1 sont évidents : le CGM permet de mieux contrôler la glycémie et de réduire les hyper- et hypoglycémies par rapport à l’autosurveillance par prélèvement d’une goutte de sang au bout du doigt. Cette technologie sauve littéralement des vies. Il est donc logique qu’elle soit largement utilisée en cas de diabète de type 1 (81 % des patients en Belgique) et qu’elle soit entièrement remboursée.
La situation est différente pour le diabète de type 2. Le CGM n’est utilisé que chez 3 % des patients et n’est que partiellement remboursé (et encore, pas pour tous les patients). Le CGM n’offre-t-il donc aucun avantage pour le diabète de type 2 ? "Si, mais le tableau est nuancé ", répond le Prof. Dr Crenier. " Le diabète de type 2 est une pathologie très hétérogène pour lequel plusieurs sous-types, ou "endotype" du diabète de type 2 ont été décrits. Et, selon l’endotype, les solutions telles que le CGM pourraient bénéficier de différentes manières aux patients. "
' La technologie médicale peut devenir un catalyseur de la médecine de précision. '
Un problème vient du fait que ces différents endotypes du diabète de type 2 ne sont pas définis assez clairement. Le CGM pourrait contribuer à pallier cette lacune : en collectant des données de glycémie issues des CGM, en les reliant aux résultats cliniques des traitements et en les interprétant à l’aide de l’IA, nous pourrions délimiter plus efficacement des sous-groupes au sein du diabète de type 2 et déterminer plus précisément quelle technologie est efficace pour quel type de patient. " La technologie médicale devient ainsi un catalyseur de la médecine de précision ", explique le Prof. Dr Crenier.
C’est aussi important pour le budget des soins de santé. "Des centaines de milliers de Belges souffrent de diabète de type 2. L’utilisation de la technologie pour des patients aussi nombreux coûte cher à la société. Mieux vaut donc intervenir avec le plus de précision possible. "
Les QALY coûtent (trop) cher
Troisième et dernier orateur à prendre la parole : Dorien Vandormael (i-mens). Elle a présenté les conclusions de la première étude clinique consacrée au parcours de soins hybride pour le diabète de type 2 et s’est penchée plus avant sur l’étude de suivi qui a récemment débuté, avec le concours de deux membres de beMedTech.
La première étude a livré des résultats prometteurs. Les patients ont perdu en moyenne 2 kg et 2 cm de tour de taille. Quelque 90 % ont déclaré préférer le suivi hybride. Et si l’on suivait des patients diabétiques pendant 22 ans, ils gagneraient en moyenne 6 années en bonne santé (Quality-Adjusted Life Years ou QALY).
'Nous devons oser laisser le patient tranquille tant que les données ne s’y opposent pas. '
"Nous sommes clairement sur la bonne voie, mais des ajustements s’imposent ", estime Dorien Vandormael. " Par exemple, la première étude n’a pas montré de diminution significative de la glycémie moyenne sur 9 mois. Le prix par QALY était, en outre, beaucoup trop élevé : près de 111 000 euros, alors que la référence est fixée à 45 000 euros en Belgique. "
"Pour changer la donne, il faut encore réduire le nombre d’interventions humaines. Nous devons oser laisser le patient tranquille tant que les données ne s’y opposent pas. Nous devons, par ailleurs, envisager des moyens intelligents de maîtriser le coût de la technologie. Je pense par exemple à des tableaux de bord de données qui peuvent être déployés à grande échelle et qui permettent aux prestataires de soins de surveiller simultanément plusieurs pathologies. Ce serait plus efficace qu’avoir une plateforme distincte pour chaque maladie. "
Stress émotionnel
Clara Debelle est parvenue à rendre concret un concept aussi théorique que les QALY. Pas au titre de Senior Associate Life Sciences chez PwC, mais au titre de patiente. On lui a diagnostiqué un diabète il y a quelques années, lors d’un examen de routine. Elle ne présentait pourtant aucun symptôme de la maladie. Le diabète s’était déclenché à la suite d’un stress émotionnel provoqué par le décès soudain de son père et tous les défis qui s’en sont suivis
Son diabète est aujourd’hui sous contrôle, mais cela lui demande beaucoup d’efforts. " Je lance un appel aux prestataires de soins : basez réellement le programme de soins sur le patient. Celui-ci se sentira beaucoup mieux. C’est d’ailleurs le meilleur moyen d’induire un véritable changement. "
Formation aux technologies de la santé
Yannis Bakhouche, médecin généraliste à Saint-Gilles, président de la section locale du MR dans cette même commune et conseiller santé auprès de Georges-Louis Bouchez, a clôturé la partie " contenu " de l’après-midi en présentant sa vision de la prise en charge du diabète et d’autres maladies chroniques.
Que retenir de son intervention ? Nous avons besoin de la technologie pour faire face à l’augmentation des maladies chroniques (Yannis Bakhouche donne des cours dans le cadre de la formation en technologies de la santé de la haute école EPHEC). Par ailleurs, il ne faut pas avoir peur de déléguer des tâches (ce n’était peut-être pas voulu, mais ce point fait écho au projet de Salvus, voir encadré). Enfin, il faut aborder les maladies chroniques dans leur globalité, en tenant compte, notamment, de la vulnérabilité socio-économique.

'L’obtention des meilleurs soins ne doit pas dépendre de vos connaissances ou de vos relations. '
Alexander Alonso, président du conseil d’administration de beMedTech et General Manager de BD Benelux, a assuré la transition avec la réception de clôture. Il a évoqué la méningite bactérienne que son fils a contractée à l’âge de 3 ans.
'Il a pu bénéficier des meilleurs soins grâce à mes connaissances du secteur et aux nombreuses relations professionnelles que j’avais à l’époque ", se rappelle Alexander. "Mais la prise en charge ne devrait pas dépendre de ces facteurs. Tout le monde en Belgique mérite d’avoir accès aux meilleurs soins. Nous devons continuer à y travailler chaque jour, tous ensemble. Let’s move the needle together. "
La conclusion parfaite d’un programme riche en contenu et l’introduction idéale à un moment de réseautage éclairant. L’événement aura-t-il jeté les bases d’idées lumineuses et de nouvelles collaborations ? Espérons-le !

L’intégration standardisée peut-elle booster la télésurveillance ?
Au lieu de devoir chaque fois procéder à une intégration distincte, une liaison standardisée sera établie entre les solutions de télésurveillance et les logiciels des établissements et prestataires de soins. Le SPF Santé publique débloque 1,5 million d’euros pour le déploiement du projet en Belgique. Le 18 septembre a eu lieu le lancement officiel.
La télésurveillance a connu un énorme essor pendant la crise du coronavirus, en particulier la solution CovidCare@Home de l’entreprise anversoise Byteflies, qui a mis en place la prescription de télésurveillance, après des discussions approfondies avec notre fédération, Agoria, la plateforme eHealth et l’Inami, et avec leur soutien.
Un projet évolutif
Andries Nelissen, chef de projet au SPF Santé publique (voir photo), explique pourquoi le gouvernement fédéral investit massivement dans ce projet : « Il apporte une grande valeur ajoutée aux hôpitaux et aux soins de première ligne. Il s’agit, en outre, d’un projet évolutif et solide sur le fond. »

« Grâce à la liaison standardisée, la plateforme ne nécessite qu’une seule connexion de la part des fournisseurs de logiciels, des fournisseurs de solutions de télésurveillance, des prestataires de soins de santé et des établissements. À l’heure actuelle, un hôpital équipé de 10 outils de télésurveillance doit encore procéder à l’intégration 10 fois, ce qui prend du temps et est cher. Résultat : l’intégration est parfois retardée ou n’est tout simplement pas réalisée. »
« À l’heure actuelle, un hôpital équipé de 10 outils de télésurveillance doit encore procéder à l’intégration 10 fois, ce qui prend du temps et est cher »
« Les fournisseurs sauront bientôt parfaitement quelles normes il convient de suivre. Ils ne devront donc plus effectuer l’intégration dans chaque hôpital séparément. »
Format standard
Si un médecin veut prescrire la télésurveillance, il pourra le faire depuis son logiciel dans un avenir proche. La demande sera transmise au fournisseur de télésurveillance choisi. Les résultats mesurés arriveront automatiquement dans le Dossier Patient Informatisé, dans un format standard.
La liaison avec le Dossier Patient Informatisé (DPI) des hôpitaux et le dossier médical global (DMG) des médecins généralistes permettra, dans une phase ultérieure, aux prestataires de soins de santé et aux patients de retrouver plus facilement toutes les données relatives à la télésurveillance.
« Chaque solution a actuellement sa propre plateforme », explique Wolf Wauters, chef de projet au sein de la plateforme eHealth. « Si un médecin souhaite consulter les données de télésurveillance de son patient, il doit souvent commencer par créer un compte, se rendre sur un site web et se connecter. Ce n’est pas très convivial et les prestataires de soins de santé n’ont pas le temps d’effectuer des recherches sur diverses plateformes externes. Ils veulent voir toutes les données dans leur système. La prescription de télésurveillance comble ce souhait. »
« Les données sont enregistrées dans le logiciel de l’hôpital ou du médecin généraliste. Grâce au système sécurisé en place pour le partage des données de santé, elles sont aussi accessibles à d’autres prestataires de soins de santé et au patient. Le système contribue ainsi à la continuité des soins. »
« Aujourd’hui, si vous changez d’outil de télésurveillance pour les arythmies cardiaques ou si votre outil disparaît, vous perdez l’historique de vos données. »
Les patients et les médecins bénéficient d’une plus grande liberté de choix, explique Wolf Wauters. « Aujourd’hui, si vous changez d’outil de télésurveillance pour les arythmies cardiaques ou si votre outil disparaît, vous perdez l’historique de vos données. Quand elles arriveront dans votre dossier de manière standardisée, elles y resteront, même si vous changez de fournisseur. Les patients et les médecins ne seront donc plus liés à une plateforme spécifique à une entreprise. »
La confiance des patients
Le système multiplie les options de suivi dont dispose le prestataire de soins. « De quoi renforcer la confiance du patient », souligne Andries Nelissen.
Le médecin spécialiste de l’hôpital n’est pas le seul à prescrire la télésurveillance. Les médecins généralistes y ont, eux aussi, de plus en plus recours. « Il n’y a pas de monopole de l’initiative, l’accent est mis sur la continuité des soins », explique Andries Nelissen. « Grâce à la liaison standardisée, le prestataire de soins de l’hôpital et le médecin généraliste pourront bientôt tous deux surveiller le patient à domicile, ses données étant automatiquement ajoutées à son dossier. C’est un énorme progrès. »
Relation thérapeutique
« Vos données resteront stockées localement, par exemple dans votre DPI au sein du système hospitalier. Il n’y a pas et il n’y aura pas de base de données centrale qui reprend l’ensemble des données de santé. C’est le patient qui décide de partager ses données et qui choisit avec qui. Un prestataire de soins de santé n’y a accès qu’en cas de relation thérapeutique avec le patient. Celui-ci a, par exemple, le droit de soumettre les résultats de sa télésurveillance à un autre médecin pour obtenir un deuxième avis. »
Une matrice d’accès régit l’accès pour chaque prestataire de soins de santé. Andries Nelissen : « Votre kiné, par exemple, ne doit voir que les données de télésurveillance de votre outil kiné. Chaque application conserve sa propre base de données et ces données seront partagées via la plateforme centrale. »
Open source
Le consortium qui entoure Byteflies recevra 1,5 million d’euros du SPF Santé publique pour déployer le projet à l’échelle belge. Andries Nelissen : « Le dossier de subvention court jusqu’à la fin 2025. Les hôpitaux n’ont pas tous les ressources et le temps nécessaires pour réaliser ce projet dans ce délai. La solution devra toutefois être à la disposition de ceux qui le souhaitent d’ici là. En open source, sans modèle de revenus. »
(lisez la suite en-desous l'encadré)
Vers un remboursement généralisé de la télésurveillance ?
L’intégration standardisée aura-t-elle un impact sur l’utilisation de la télésurveillance ? Wolf Wauters, de la plateforme eHealth, pense que oui. « Les médecins pourront la prescrire plus facilement et consulter et partager les résultats plus aisément. La qualité des soins n’en sera que meilleure. »
« C’est la première fois que le secteur propose lui-même une solution standard pour l’intégration de différents systèmes, dans une optique louable de standardisation et de sécurité des données. Le succès d’un déploiement à grande échelle serait, à mon sens, un formidable argument en faveur du remboursement généralisé de la télésurveillance. »

« La prescription de la télésurveillance est actuellement testée dans deux hôpitaux et au moins 30 établissements devraient déjà être connectés dans un an et demi. Nous proposerons ensuite des incitants pour que les autres suivent le mouvement. Nous voulons que tous les prestataires de soins et tous les patients puissent l’utiliser. À cet effet, la plateforme centrale de prescription doit être reliée à tous les principaux DPI. Comme il y en a sept dans notre pays, c’est faisable. »
Questions juridiques
Mais il reste encore quelques obstacles à surmonter. Andries Nelissen : « Comment éviter une surcharge de données ? Comment gérer les différentes phases du programme de soins du patient ? Et qu’en est-il de l’aspect juridique et pratique de la plateforme centrale de prescription ? Autant de défis à relever dans les mois et les années à venir. »
Lisez-en plus sur le site officiel du projet : www.telemonitoring-prescription.com

Des moyens fédéraux pour une étude de suivi sur le monitoring du diabète à domicile
Le parcours de soins hybride pour le diabète de l’AZ Maria Middelares et i-mens reçoit un financement du SPF Santé publique aux fins d’une nouvelle étude clinique. L’étude de suivi devrait, on l’espère, confirmer les résultats prometteurs de la première étude. Au niveau du logiciel, le choix du partenaire s’est porté sur Comarch. « Notre application de télésurveillance est modulaire », explique Stef Schots. « On s’en sert pour le diabète dans ce cas-ci, mais rien n’empêche de l’utiliser pour d’autres maladies. »
Une première étude clinique relative au parcours de soins hybride pour le diabète de type 2 s’est terminée il y a peu. Elle portait sur 100 sujets. Les 50 patients diabétiques du groupe test ont mesuré leur glycémie et leur tension artérielle chez eux pendant neuf mois. Ces valeurs étaient envoyées sur leur smartphone via Bluetooth et transmises, via l’app HomeHealth 2.0 de Comarch, aux opérateurs infirmiers de la centrale de soins Z-plus.
Ces opérateurs surveillaient les patients 24 h/24. En cas de valeurs anormales, d’évolution négative ou d’enregistrement manqué de paramètres, ils contactaient le patient, envoyaient un éducateur en diabétologie sur place ou, si nécessaire, appelaient un médecin ou une ambulance.
Une glycémie plus stable
« Notre étude a montré une réduction des pics et des chutes de glycémie chez les participants », explique Dorien Vandormael, responsable de l’innovation chez i-mens. « Les patients contrôlaient donc mieux leur glycémie. En revanche, nous ne sommes pas encore parvenus à démontrer une diminution significative de la valeur HbA1c, c’est-à-dire la glycémie moyenne sur 2 ou 3 mois. Cela s’explique par la taille restreinte du groupe et la durée limitée de l’étude. »
« Avec les nouvelles technologies, le défi consiste à ne pas perdre le côté humain. Les soins à distance ne doivent pas devenir une usine et les patients doivent utiliser votre solution avec plaisir. C’est le cas ici : la plupart des participants ont préféré le nouveau parcours de soins à l’éducation au diabète classique. Si tel n’avait pas été le cas, nous aurions immédiatement tout arrêté. »
Le coût doit baisser
Les partenaires du projet ont également examiné le rapport coût-efficacité. Dorien : « Il ressort de cette analyse que si l’on suivait des patients diabétiques pendant 22 ans dans le cadre d’un parcours hybride, on estime qu’ils gagneraient 5,97 années en bonne santé (Quality-Adjusted Life Years ou QALY). Un excellent résultat sur le plan individuel, mais sur le plan macro-économique, le coût reste trop élevé. La référence actuelle pour une QALY gagnée dans notre pays est de 45 000 euros. Dans notre projet, nous tournons encore autour des 100 000 euros. »
« Si l’on suivait des patients diabétiques pendant 22 ans dans le cadre d’un parcours hybride, on estime qu’ils gagneraient 5,97 années en bonne santé. Mais le prix par année est encore trop élevé. »
« Nous voulons faire baisser le prix en augmentant l’efficacité et en suivant les patients plus longtemps. C’est au début que le nombre d’interventions est le plus élevé. Au terme de l’étude, on n’en dénombrait plus qu’une par patient et par mois. Nous voulons encore réduire ce chiffre. Le coût de la technologie doit baisser, lui aussi. »
Compte tenu des résultats prometteurs, une étude de suivi va à présent être réalisée sur deux fois plus de patients pendant 11 mois. Dorien : « Le SPF Santé publique nous accordera 800 000 euros de subventions dans le cadre de l’appel à projets numériques innovants lancé fin 2023. L’AZ Maria Middelares porte le projet avec nous et quatre autres hôpitaux. »
Convivialité

Le parcours de soins hybride sur le diabète fait appel au logiciel de Comarch. « Notre solution se compose de deux éléments », explique Stef Schots, Business Development Manager e-health Benelux. « HomeHealth est l’application qui aide le patient à mesurer ses paramètres et lui rappelle de les mesurer. Cette assistance peut prendre la forme de texte ou d’images. »
Ce n’est pas anodin, poursuit Dorien : « Les patients qui souffrent de diabète de type 2 ont un horaire de mesure assez irrégulier. Ces rappels leur sont d’une aide précieuse. S’ils oublient une mesure, un opérateur infirmier de Z-plus les contacte. »
« Les patients qui ont recours à la télésurveillance souffrent généralement d’une maladie chronique ou sont suivis avant ou après une intervention chirurgicale », explique Stef. « Ils ont souvent un certain âge. Nous devions donc développer une app aussi conviviale que possible. On ne voit que les boutons indispensables. »
Qu’est-ce qu’une télésurveillance efficace ?
Il manque encore un cadre cohérent, estime Dorien. « Nous aimerions que l’INAMI définisse avec précision la télésurveillance de qualité et l’intervention au bon moment. »
« Ce qui coûte le plus cher avec la télésurveillance, ce ne sont pas les interventions, mais la disponibilité 24 h/24. Un constat en contradiction avec l’actuel système de financement à la prestation dans notre pays. Pour s’imposer socialement, la télésurveillance et les soins à distance ont besoin d’une forme de financement basée sur la valeur, qui encourage les organisations à maintenir leurs patients en bonne santé. »
Dorien : « Dans le cadre de la nouvelle étude, les patients pourront indiquer dans quel domaine ils souhaitent une aide : sevrage tabagique, alimentation plus saine ou activité physique accrue. Ils pourront contacter facilement un tabacologue ou un diététicien, et recevoir des conseils via l’app. Un questionnaire leur sera soumis chaque mois pour faire le point. Z-plus leur apportera alors une aide ciblée. »
Autres maladies
Outre HomeHealth, la solution de Comarch comprend également e-Care, une plateforme numérique qui alerte l’équipe soignante en cas de mesures anormales.
« Notre solution est modulaire », explique Stef Schots. « Nous nous en servons actuellement pour le diabète, en collaboration avec i-mens, mais rien n’empêche de l’utiliser pour d’autres maladies. L’Algemeen Stedelijk Ziekenhuis d’Alost mène un projet pilote dans le cadre duquel des patients atteints de maladies cardiaques chroniques sont suivis à domicile avec HomeHealth. Nous lancerons, à l’automne, une étude de faisabilité pour quatre autres pathologies. »
« Les soins à domicile engendrent encore trop souvent une perte de temps qui pourrait être évitée. »
Pour Dorien, les soins hybrides sont des soins personnalisés, prodigués au bon moment par la bonne personne. « Les soins à domicile engendrent encore trop souvent une perte de temps. Vous arrivez chez le patient et vous vous rendez compte que votre visite n’est pas nécessaire ce jour-là. Nous voulons éviter cette perte de temps en travaillant à partir de données afin de déterminer quand le patient a besoin de nous et si notre présence physique apporte une valeur ajoutée. La proximité des soins s’en trouve-t-elle compromise ? Absolument pas : vous êtes là quand le patient en a le plus besoin. »
Une app qui rassure
L’app de soins à domicile pour le diabète n’est pas non plus une belle-mère ou un beau-père qui vous rappelle à l’ordre constamment, explique Dorien.
« Les patients trouvent que l’app les assure : si leurs valeurs ne sont pas bonnes, on les appellera ou l’éducateur en diabétologie passera les voir. Il ne s’agit donc pas de remplacer l’éducation à domicile au diabète, mais de la compléter par la télésurveillance et les soins à distance. D’où le qualificatif “hybride”. La dimension humaine est maintenue. Vous serez toujours en contact avec un collaborateur de Z-plus, pas avec un robot ou une IA. »
Demande de remboursement
i-mens souhaite que le parcours de soins hybride fasse l’objet d’un remboursement classique. « Nous allons déposer une demande remboursement au titre d’application mobile médicale auprès de l’INAMI », explique Dorien. « Si cette demande aboutit, la voie sera ouverte pour d’autres applications. Car les soins hybrides font désormais partie de la stratégie de base d’i-mens. »
« Nous comptons introduire la demande cet automne. Nous devrons ensuite attendre 18 mois avant de connaître la décision. Un long délai ? Pas vraiment. C’est même plutôt rapide dans le domaine des soins. Dans le scénario idéal, les patients qui participent à la deuxième étude pourront directement bénéficier d’un parcours de soins remboursé. »


UZ Leuven : « Nous devons utiliser des outils numériques pour assurer le suivi adéquat de tous les patients porteurs d’un implant cochléaire »
Plus de 5 000 personnes portent un implant cochléaire (IC) en Belgique. Et quelque 500 nouveaux porteurs s’y ajoutent chaque année. Il s’agit de personnes souffrant d’une perte auditive sévère, pour laquelle les appareillages classiques ne suffisent plus. L’UZ Leuven a récemment adopté une application pour assurer le suivi des utilisateurs d’IC. « L’application permet aux patients de gagner du temps et peut également contribuer à alléger notre charge de travail », témoigne l'audiologiste Lieselot Van Deun.
Un implant cochléaire (IC) apporte une solution auditive aux personnes souffrant d’une perte auditive sévère qui ne peuvent pas être aidées par une aide auditive conventionnelle. L’implant cochléaire se compose de deux parties : un processeur externe qui capte les sons et les convertit en signaux numériques et l’implant interne qui transmet les signaux directement au nerf auditif par l’intermédiaire d’électrodes situées dans la cochlée.
Avec Remote Check de Cochlear, les patients peuvent désormais choisir de faire effectuer des contrôles depuis leur domicile. Remote Check est intégré à l’application Nucleus® Smart App fournie avec l’implant cochléaire.

L’application permet aux professionnels de la santé de réaliser des tests fonctionnels à distance pour s’assurer que l’implant offre un soutien optimal à l’utilisateur. Ils peuvent, en outre, utiliser l’application pour déterminer si l’utilisateur a besoin d’un examen complémentaire à l’hôpital.
« Une pièce importante du puzzle »
L’UZ Leuven est l’un des hôpitaux qui ont adopté la fonction de télésurveillance. L’équipe de l’IC de Louvain considère l’application comme un élément essentiel des soins modernes.
Le Dr Nicolas Verhaert (UZ Leuven), professeur en oto-rhino-laryngologie témoigne : « Il est important que nous puissions assurer des soins médicaux d’une qualité suffisante et que nous puissions aider les nouveaux patients souffrant de déficience auditive en temps opportun. Le fait qu’une partie des soins de suivi ait lieu à domicile est une pièce importante de ce puzzle. »
« Pour le patient, l’application permet un réel gain de temps : il doit se rendre beaucoup moins souvent à l’hôpital. »

« Nous déployons aujourd’hui cet outil à grande échelle, à la fois auprès des jeunes et des anciens utilisateurs d’IC », ajoute Lieselot Van Deun (photo), responsable Audiologie au sein du département ORL de l’UZ Leuven.
Le plus grand avantage pour le patient ? Le gain de temps. « Pour beaucoup de gens, il n’est pas évident de systématiquement se rendre à l’hôpital, que ce soit pour des raisons professionnelles, familiales ou autres. Grâce à l’application, ils gagnent donc un temps précieux, même si les contrôles physiques restent nécessaires de temps à autre », explique Van Deun.
« Certaines personnes préfèrent avoir un rendez-vous physique avec un audiologiste ou un médecin, ce qui est bien sûr toujours possible. »
Triage
Pour l’équipe ORL, l’application de télésurveillance est aussi synonyme d’efficacité accrue. « Les patients font un autotest, nous procédons à un triage et invitons ensuite ceux qui ont besoin d’un contrôle physique. À terme, nous pourrons consacrer plus de temps aux personnes qui en ont besoin, vu que nous n’aurons plus à inviter tout le monde pour un contrôle annuel, » affirme Van Deun.
« À terme, nous ne devrons plus inviter tous les patients pour un contrôle annuel, ce qui nous permettra de consacrer plus de temps à ceux qui ont vraiment besoin d’un suivi à l’hôpital. »
Van Deun souligne toutefois qu’il reste encore du travail pour intégrer de manière transparente l’utilisation de l’application dans le protocole de soins. « Nous utilisons déjà l’application dans la pratique aujourd’hui, mais nous n’en sommes qu’au début. Nous devons maintenant intégrer l’application dans notre protocole de soins afin de savoir clairement comment et quand l’utiliser. »
« Nous étudions, par exemple, la possibilité de recourir au contrôle à distance dès les premières semaines qui suivent l’implantation d’un implant, car c’est durant cette période que le suivi et les contrôles intensifs des patients sont les plus nécessaires. »
Alléger la charge de travail
Les applications numériques auront-elles bientôt une place structurelle dans les soins de santé ? « J’en suis convaincue », affirme Van Deun.
« Avec le personnel dont nous disposons, nous ne pouvons pas continuer à suivre physiquement tout le monde avec la même intensité. Les outils numériques intelligents comme celui-ci sont un aspect important de la solution pour créer des efficiences dans les parcours de soins afin de maintenir la charge de travail supportable pour les soignants, sans sacrifier la qualité des soins. »
«Innover n'est possible qu’avec le soutien des soignants et des pouvoirs publics »
« L’innovation est cruciale pour trouver des réponses aux défis actuels et futurs dans le domaine des soins de santé », déclare Niels van Druten, General Manager de Cochlear Benelux. « Avec Remote Check, nous entendons offrir aux patients deux choses essentielles : la qualité de vie, sous la forme d’un gain de temps, et la garantie qu’ils recevront également le meilleur suivi médical possible depuis leur domicile. »
« Mais nous ne pouvons pas le faire seuls », conclut M. van Druten en lançant un appel. « Un tel projet ne peut réussir qu’avec le soutien des soignants qui utilisent la technologie dans la pratique. Et avec le soutien de pouvoirs publics qui encouragent l’adoption d’outils numériques par le biais d’un cadre de remboursement transparent et équitable. »

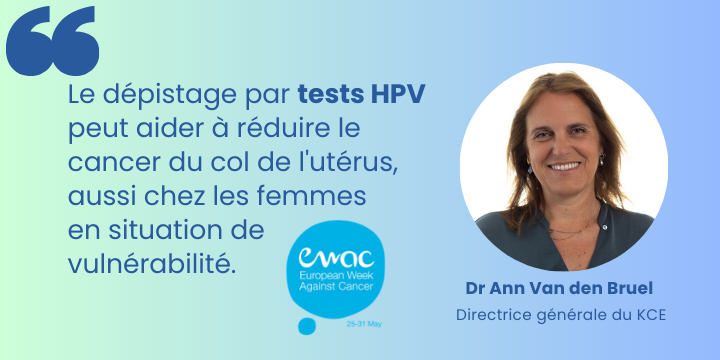
Les soins efficaces contre le cancer et le diagnostic in vitro vont de pair
Une meilleure utilisation des diagnostics in vitro est cruciale dans la lutte contre le cancer. Cette Semaine européenne contre le cancer est donc l’occasion de mettre à nouveau en avant les recommandations de MedTech Europe, lesquelles sont également pertinentes pour la Belgique.
Un diagnostic précoce du cancer est crucial pour réduire l’impact de la maladie sur le patient, son entourage et la société. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a fait passer ce message sans détour en 2017, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer.
Les DIV et le dépistage
Le dépistage est essentiel au diagnostic précoce. Il repose notamment sur les diagnostics in vitro (DIV). Une publication de l’OMS sur la gestion du cancer répertorie une série de tests de diagnostic in vitro prioritaires pour des programmes de dépistage efficaces.
On n’exploite, hélas, pas suffisamment le potentiel des DIV à l’heure actuelle, estime MedTech Europe dans son rapport intitulé The Value of Diagnostic Information in Cancer Care, publié en 2022.
Il est parfois question de force majeure. Prenons l’exemple de la baisse de 40 % du nombre de diagnostics de cancer en Belgique entre 2019 et 2022. Elle s’explique par le report des soins (comme les programmes de dépistage) en raison de la pandémie de coronavirus.
Cancer du col de l’utérus
Dans d’autres cas, la cause se trouve ailleurs, par exemple dans la politique (ou l’absence de politique). MedTech Europe cite l’exemple du cancer du col de l’utérus. Les chances de survie des patientes sont très élevées (92 %) en cas de dépistage précoce. Le taux de survie à 5 ans tombe à 58 % en présence de métastases dans les organes et tissus voisins et à 18 % en cas de métastases dans d’autres parties du corps. D’où l’importance de procéder à un dépistage régulier, qui reste néanmoins trop rare.
Les chances de survie des patientes atteintes d’un cancer du col de l’utérus sont très élevées en cas de dépistage précoce, mais il est encore trop peu pratiqué.
Le type de test joue également un rôle. Le dépistage primaire reposait généralement sur un frottis cervical qu’on analysait en laboratoire pour identifier d’éventuelles anomalies cellulaires (examen cytologique). Avec le test de dépistage du papillomavirus humain (HPV), on dispose désormais d’un test moléculaire : au lieu d’étudier les anomalies cellulaires, ce test cherche la présence du HPV, puisqu’il existe un lien étroit entre ce virus et le cancer du col de l’utérus.
Le test de dépistage du HPV devrait permettre de détecter et donc de traiter davantage de cancers du col de l’utérus à un stade précoce, ce qui se traduirait par un meilleur pronostic pour la patiente. Mais ce test est loin d’être utilisé partout en Europe.
KCE : « L’objectif de 85 % de couverture du dépistage n’a pas été atteint en 2021 »
Le dépistage du cancer du col de l’utérus en Belgique peut et doit être amélioré, selon un rapport du Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE), paru en 2024.
Dr Ann Van den Bruel, directrice générale du KCE : « L’objectif de 85 % pour le dépistage du cancer du col de l’utérus n’a pas été atteint en 2021. À peine 57 % des personnes cibles se sont fait dépister. Ce pourcentage était encore plus faible chez les femmes ayant droit à un remboursement majoré. La vaccination contre le HPV, le dépistage avec test HPV et la possibilité d’autotest peuvent contribuer à réduire davantage le cancer du col de l’utérus dans tous les groupes, y compris ceux qui sont vulnérables sur le plan socio-économique. »
Au sein de l’UE, seules la Suède, la République tchèque, l’Irlande, la Finlande et la Slovénie ont atteint des taux de couverture acceptables (70 %). Sur une note positive, la Belgique a récemment décidé de dépister tous les cinq ans les femmes âgées de 30 à 64 ans au moyen du test moléculaire du papillomavirus.
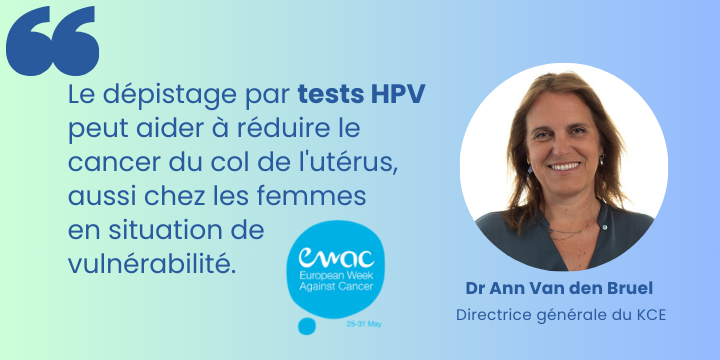
Pronostic moins favorable
Que le diagnostic tardif soit dû à un cas de force majeure ou non, les conséquences pour le patient sont les mêmes : comme le traitement ne peut être entamé que plus tard, l’efficacité de la thérapie, les chances de guérison, la qualité de vie s’en trouvent compromises.
MedTech Europe appelle donc les décideurs politiques européens à investir encore davantage dans des initiatives ciblées en matière de dépistage et de détection précoce du cancer. Dans l’intérêt des patients et de leurs familles, mais aussi dans celui des soins et de la société.
Quand le cancer est diagnostiqué à un stade précoce, le traitement coûte deux à quatre fois moins cher qu’en cas de diagnostic à un stade plus avancé.
Quand le cancer est diagnostiqué à un stade précoce, le traitement coûte, en effet, deux à quatre fois moins cher qu’en cas de diagnostic à un stade plus avancé. Sans compter les coûts indirects tels que la perte de productivité économique (du patient et des aidants proches).
Le continuum complet de soins du cancer
Le rôle des DIV dans le traitement du cancer ne se limite d’ailleurs pas au dépistage. Selon MedTech Europe, les DIV sont indispensables du début à la fin du continuum des soins : de la prévention au suivi de l’évolution de la maladie, en passant par le dépistage, la détection précoce, le diagnostic et (le choix de) la thérapie.
(lisez la suite sous l'image)

L’organisation faîtière européenne étaye son propos par une série d’exemples autres que le dépistage du cancer du col de l’utérus : diagnostics in vitro dans le cadre d’un cancer du sein, tests de mutation génétique au moment de choisir la bonne thérapie ciblée pour traiter le cancer colorectal métastatique, biopsies liquides pour surveiller l’effet du traitement du cancer du poumon.
MedTech Europe conclut en adressant cinq recommandations concrètes aux décideurs politiques européens, lesquelles sont aussi hautement pertinentes dans le contexte belge :
- renforcer les lignes directrices, les infrastructures et les programmes nationaux de dépistage et de détection précoce ;
- réduire les inégalités face au cancer, par exemple les différences au niveau du délai de diagnostic entre les groupes, dans la participation aux programmes de dépistage, etc. ;
- améliorer l’accès des patients aux outils de diagnostic innovants, notamment via un remboursement ponctuel des DIV de grande valeur ;
- moderniser l’évaluation des DIV, avec une plus grande attention portée à leur impact sur l’économie de la santé à tous les stades du continuum des soins du cancer ;
- préparer les systèmes de soins de santé aux futures crises sanitaires afin d’assurer la continuité des soins prodigués aux personnes atteintes d’un cancer à tout moment.
Europe’s Beating Cancer Plan
Si l’Europe n’abrite qu’environ un dixième de la population mondiale, elle représente un quart des cas de cancer à l’échelle internationale. À l’heure actuelle, 20 % des décès en Europe sont dus au cancer. En 2035, le cancer sera la première cause de décès sur le continent. Et la liste des prévisions de ce genre est encore longue…
Ces chiffres s’expliquent : le cancer est une « maladie de vieillesse » et l’Europe est actuellement le continent dont la population est la plus âgée. Mais nous devons aussi y voir un signal d’alarme : l’investissement dans le traitement du cancer devrait être une priorité européenne. D’une part, pour permettre aux personnes atteintes d’un cancer de vivre le plus longtemps possible en gardant la meilleure qualité de vie possible et, d’autre part, pour prévenir autant que possible l’apparition de nouveaux cas.
C’est la raison pour laquelle l’Union européenne a lancé le Europe’s Beating Cancer Plan (EBCP) en 2021. Cette initiative européenne pour vaincre le cancer est un plan ambitieux assorti des budgets nécessaires pour concrétiser ces ambitions.
Déploiement en Belgique
Le Centre du Cancer de Sciensano coordonne la mise en œuvre des plans européens en Belgique. Ce déploiement s’effectue par l’intermédiaire du Belgian EBCP Mirror Group, qui comporte sept groupes de travail thématiques autour de sept domaines clés des soins du cancer.
Les personnes qui souhaitent en savoir plus sur les activités du groupe et/ou rejoindre un ou plusieurs groupes de travail thématiques peuvent consulter le site web www.beatingcancer.be.
Cliquez ICI pour télécharger le rapport complet « The Value of Diagnostic Information in Cancer Care » (2022) de MedTech Europe.
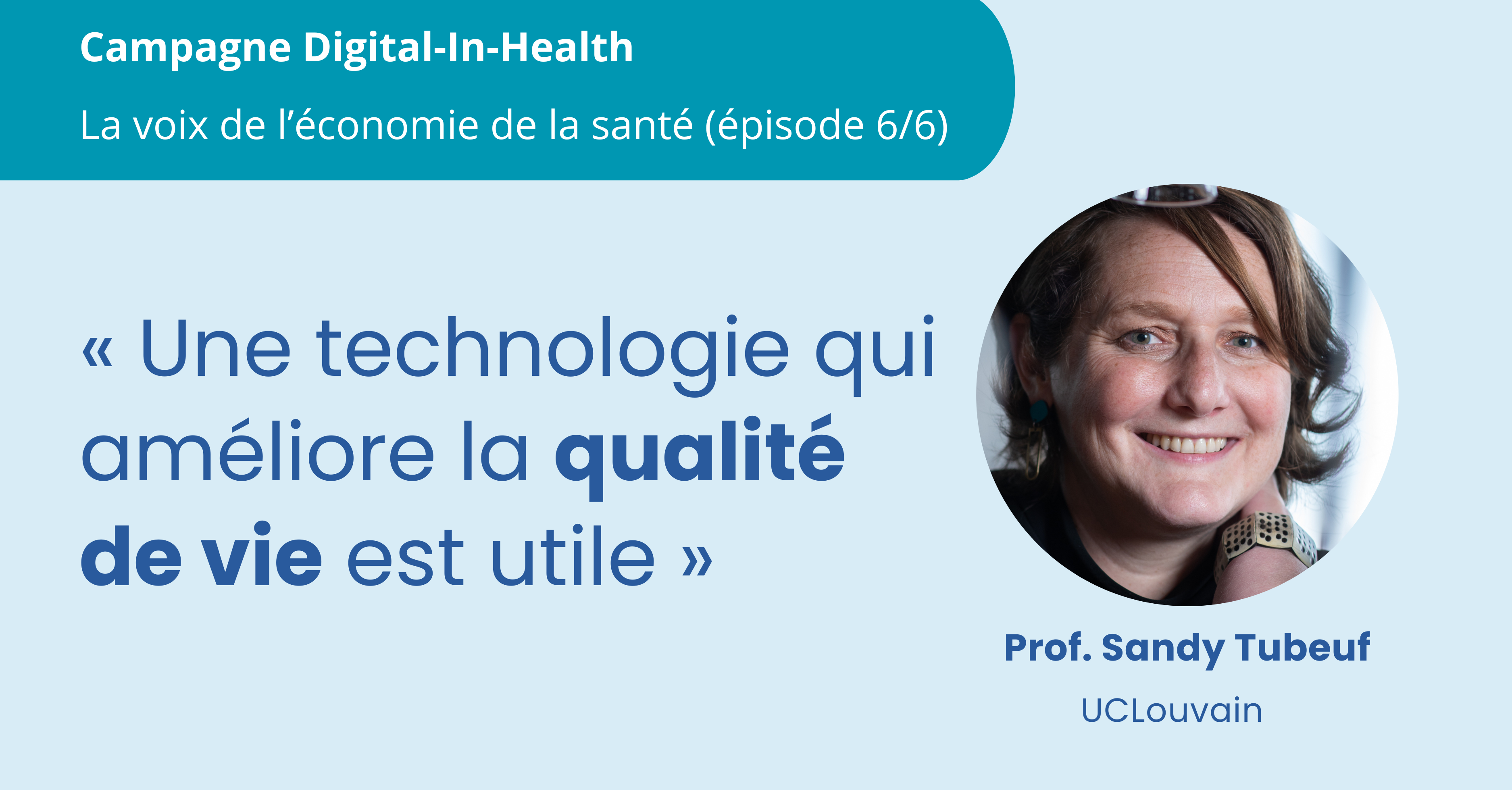
« Les nouvelles technologies doivent améliorer les années en bonne santé »
Pour le Pr Sandy Tubeuf, professeure d’économie de la santé à l’UCLouvain, une technologie qui apporte un gain sur la qualité de vie est utile, même si elle ne permet pas de réaliser directement des économies. L'interview s'inscrit dans la campagne Digital-In-Health de l'Inami à laquelle notre fédération participe (voir également l'encadré en bas de page pour plus d'info).
Quel regard portez-vous sur les nouvelles technologies en santé au niveau de la recherche ?

« Ce qui me semble important, c’est de chercher à comprendre comment ces nouvelles technologies améliorent ou pas le parcours de soins des patients. »
« Au niveau de la recherche, cela intéresse différentes disciplines. En tant qu’économiste de la santé, je me demande si elles améliorent la santé des patients, leur parcours de soins et si elles sont coût-efficaces[1]. »
« Mes collègues éthiciens s’interrogeront sur la relation médecin-patient qui devient virtuelle ou à distance ; les sociologues se pencheront sur la capacité d’utiliser la technologie pour tous les patients et la possible mise en évidence d’inégalités, etc. »
Vous êtes donc en train de dire que les nouvelles technologies doivent être approchées avec un regard interdisciplinaire ?
« En effet. Le cadre d’évaluation de telles nouvelles technologies doit mobiliser différentes disciplines pour être le plus robuste et le plus approprié possible. C’est le plaidoyer que nous avons tenu dans une recherche interdisciplinaire où nous mettions en avant que nos disciplines respectives proposaient chacune des outils limités à une seule dimension. »
« Il est essentiel de mesurer comment ces nouvelles technologies atteignent les objectifs de santé. »
« La capacité à prendre différentes dimensions ensemble permettrait une évaluation plus complète et appelait donc à l’interdisciplinarité. »
Si on revient à votre casquette d’économiste de la santé, qu’apportent, selon vous, les nouvelles technologies en santé ?
« Il est essentiel de mesurer comment ces nouvelles technologies atteignent les objectifs de santé. Il s’agit de savoir si elles améliorent les années en bonne santé, le parcours de soins et aussi si elles sont un substitut à un autre soin ou si elles arrivent en support additionnel. »
« Selon moi, même si elle ne permet pas de faire des économies, la technologie qui améliore la qualité de vie reste utile. »
Ces nouvelles technologies peuvent-elles être coût-efficaces ?
« Si une technologie vient remplacer un autre soin, elle peut être coût-efficace, mais il faudra le vérifier. »

« Il me paraît important d’analyser ce qui se passe avec les patients pour lesquels la technologie n’est pas envisageable. Selon moi, on ne peut pas présupposer que tous les individus accepteront d’utiliser une technologie et en bénéficieront. Il est important d’analyser dans un premier temps l’efficacité et dans un second temps le rapport coût-efficacité. »
Quelles sont les points d’attention par rapport à ces nouvelles technologies ?
« A mes yeux, il est important d’avoir une adhésion tripartite autour de l’utilisation de nouvelles technologies. Une nouvelle technologie utilisée par un patient mais pas par son prestataire de soins ou son assureur est vouée à l’échec. »
« Une nouvelle technologie utilisée par un patient mais pas par son prestataire de soins est vouée à l’échec. »
« L’utilisation de la nouvelle technologie fait partie d’un contrat qui lie les différents membres de la relation médicale. Il s’agit, selon moi, d’une condition sine qua non à la réussite de l’utilisation de ces technologies. »
[1] Coût-efficace fait référence à une approche ou une méthode qui atteint son objectif tout en tenant compte à la fois du coût (combien est dépensé) et de l’efficacité (à quel point cela fonctionne). En somme, être coût-efficace signifie trouver un équilibre entre les coûts engagés et les résultats obtenus, afin d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix.
Campagne Digital-In-Health
Cette interview s'inscrit dans la campagne Digital-In-Health de l'Inami.
Intégrer des technologies numériques innovantes aux soins de santé peut apporter une valeur ajoutée tant aux patients qu’aux prestataires de soins. Avec cette campagne, l'Inami veut faire connaître davantage encore aux prestataires toutes les possibilités offertes par une intégration pertinente de ces technologies dans leurs processus de soins et les inviter à sauter le pas.
Notre fédération soutient l'initiative en collaboration avec Agoria.


« La confiance et le financement : ingrédients essentiels pour la percée des soins assistés par le numérique »
Les soins assistés par le numérique ne devraient pas être une obligation. Les prestataires de soins et les patients doivent vouloir s’y mettre d’eux-mêmes. C’est ce qu’affirme Steven Vandeput, conseiller en technologies médicales numériques et en services et technologies d’assistance à domicile chez beMedTech. L'interview s'inscrit dans la campagne Digital-In-Health de l'Inami à laquelle notre fédération participe (voir également l'encadré en bas de page pour plus d'info).
beMedTech collabore à la campagne « Digital-In-Health » de l'Inami dans la presse médicale. Une telle campagne était-elle nécessaire?
« Certainement! Aujourd’hui, la plupart des initiatives relatives aux soins assistés par le numérique sont des projets pilotes menés dans un nombre limité d’hôpitaux et avec un nombre restreint de patients. Pour percer à grande échelle, deux éléments sont nécessaires: un cadre de financement clair et une confiance suffisante chez les prestataires de soins. »
« Car au final, ce sont les prestataires de soins qui décident, avec leurs patients, d’utiliser ou non des outils numériques dans un trajet de soins. »
Comment estimez-vous aujourd’hui cette confiance chez les prestataires de soins?
« Les possibilités offertes par les technologies médicales numériques sont encore insuffisamment connues chez de nombreux prestataires de soins. Et il est difficile de faire confiance à quelque chose que l’on ne connaît pas (bien)... »

« Avec cette campagne, l'Inami souhaite rendre tangibles les avantages des soins assistés par le numérique pour les dispensateurs de soins et répondre à leurs préoccupations. Avec beMedTech, nous sommes heureux de nous y atteler, en collaboration avec Agoria. Bien entendu, une seule campagne ne suffira pas. Instaurer la confiance est un marathon, pas un sprint. »
« Instaurer la confiance est un marathon, pas un sprint. »
« Des efforts sont également nécessaires dans d’autres domaines. Par exemple, des formations à destination des prestataires de soins et des initiatives en matière de littératie numérique pour les patients. Ce n’est pas pour rien que la littératie numérique en santé était inscrite à l’agenda européen en mars, à l’initiative des mutualités belges. »
Vous mentionniez le financement comme deuxième condition.
« Sans financement structurel, les soins assistés par le numérique ne peuvent pas percer. Cela signifie que nous devons également instaurer un climat de confiance auprès des décideurs politiques. Tant qu’ils ne seront pas convaincus de la valeur ajoutée des soins assistés par le numérique, un cadre de financement ne pourra être établi. »
« Il n’y a pas si longtemps, les décideurs politiques considéraient les outils numériques principalement comme un coût pour les soins, et non comme un levier pour améliorer la qualité et l’efficience des soins. Mais la situation est clairement en train de changer. Les décideurs politiques comprennent de plus en plus notre potentiel. »
« Cette campagne en est la preuve. L'Inami envoie un message clair: nous croyons en la valeur ajoutée des soins assistés par le numérique. De plus, cette confiance va de pair avec le financement. En octobre 2023, l'Inami a lancé un nouveau cadre de financement pour les applications médicales mobiles. »
« Avec cette campagne, l'Inami envoie un message clair: nous croyons en la valeur ajoutée des soins assistés par le numérique. »
« Ce nouveau cadre est-il déjà parfait? Non, mais c’est logique. Il s’agit toutefois d’une nette amélioration. Et une déclaration: les soins assistés par le numérique sont là pour durer. »
Comment la Belgique se situe-t-elle par rapport aux autres pays?
« Lorsque les projets pilotes relatifs à l’e-santé ont été lancés en 2016, notre pays était un pionnier sur la scène internationale. Aujourd’hui, il n’y a toujours pas de financement structurel pour une seule application, alors que 4 à 5 applications ont reçu une évaluation positive il y a déjà plusieurs années. »
« Pendant ce temps, nos pays voisins nous dépassent. En France et en Allemagne, par exemple, les autorités remboursent déjà toute une série d’applications numériques. Même si cela ne se résume pas à cela. »
Qu’entendez-vous par là précisément?
« En Belgique, nous ne voulons pas financer les technologies en tant que telles, mais bien leur utilisation dans le cadre d’un trajet de soins. C’est une question de bon sens. Mais élaborer un cadre de financement intégré à cet effet nécessite beaucoup plus de temps que rembourser simplement des applications. »
« Nous ne plaidons pas pour qu’un tel cadre transversal soit élaboré à la hâte, mais bien suffisamment vite. Sinon, nous raterons des opportunités pour les patients et les prestataires de soins belges. »
Si vous pouviez voir se réaliser un rêve cette année, quel serait-il?
« Obtenir un financement pour au moins 3 ou 4 trajets de soins assistés par le numérique. Cela ouvrirait soudain des perspectives d’innovation numérique dans d’autres itinéraires de soins. Car voir l’innovation, suscite l’innovation. Et l’innovation est essentielle pour améliorer en permanence les soins aux patients. »
Campagne Digital-In-Health
Cette interview s'inscrit dans la campagne Digital-In-Health de l'Inami.
Intégrer des technologies numériques innovantes aux soins de santé peut apporter une valeur ajoutée tant aux patients qu’aux prestataires de soins. Avec cette campagne, l'Inami veut faire connaître davantage encore aux prestataires toutes les possibilités offertes par une intégration pertinente de ces technologies dans leurs processus de soins et les inviter à sauter le pas.
Notre fédération soutient l'initiative en collaboration avec Agoria.


Briganti : « La Belgique s’érige en véritable pionnier de formation des médecins à l’IA »
L’intelligence artificielle va bouleverser les soins de santé. Pour contribuer à concrétiser ce futur, il est crucial pour les médecins de comprendre l’IA. C’est en ce sens que le Dr Giovanni Briganti a créé la chaire « Intelligence artificielle et médecine digitale » à l’Université de Mons pour l’année académique 2022-2023, avec le soutien de Reflexion Medical Network.
Durant l’année académique dernière, la Belgique a été l’un des premiers pays du monde à intégrer un cours obligatoire sur l’intelligence artificielle (IA) dans le cursus de médecine, et ce à l’Université de Mons (UMons), ce qui a enclenché une véritable « dynamique pour l’enseignement de l’IA en médecine » dans notre pays, explique le Dr Giovanni Briganti, titulaire de la chaire « Intelligence artificielle et médecine digitale » à l’UMons.
Docteur Briganti, le lancement de la chaire à l’UMons remonte à l’année académique dernière. Quel regard portez-vous sur cette période ?
« L’introduction de l’IA dans le programme d’études était une évidence pour moi. Les statistiques et l’épidémiologie constituent depuis longtemps l’épine dorsale de la médecine factuelle. Les concepts de l’IA sont une extension de ces principes statistiques, mais appliquée d’une manière plus avancée et automatisée. »
« Jusqu’il y a peu, de nombreux médecins et universitaires étaient pourtant convaincus qu’un médecin n’était pas apte à devenir un “praticien de l’IA”. Heureusement, grâce à l’entrée en scène fracassante de ChatGPT, entre autres, les médecins ont pris conscience qu’ils ne pouvaient et ne devaient pas rester à la traîne. La Belgique s’érige désormais en pionnier de la formation des médecins à l’IA. »
« Le lancement de la chaire à Mons, avec le soutien du groupe de presse Reflexion Medical Network, a fait des émules dans plusieurs autres universités belges. En Fédération Wallonie-Bruxelles, Liège (ULiège), Louvain-la-Neuve (UCL) et Bruxelles (ULB) ont également accordé une place à l’IA dans le cursus de médecine. Je m’en réjouis ! »
Pourquoi jugez-vous si important que les jeunes médecins soient formés à l’IA ?
« Une exposition précoce à l’IA permet aux étudiants en médecine d’acquérir une compréhension approfondie du fonctionnement de ces technologies. Ils sont alors mieux à même de porter un regard critique sur les outils d’IA et leurs applications en milieu clinique. »
« Ce regard éclairé est crucial à l’heure où l’IA est de plus en plus utilisée dans les soins de santé, notamment pour l’aide au diagnostic, la planification du traitement et le suivi des patients. »
« Les futurs médecins doivent être en mesure de contribuer à la transformation numérique de notre système de soins de santé. »
« Les futurs médecins ne doivent pas devenir de simples “utilisateurs” de ces nouveaux outils. Leur responsabilité va bien au-delà. Ils doivent être en mesure d’évaluer la qualité des technologies. Ils doivent pouvoir promouvoir leur mise en œuvre pertinente, efficace et éthique sur le terrain. Et ils doivent pouvoir contribuer à orienter le développement de nouveaux outils d’IA dans la bonne direction afin de maximiser l’impact de l’innovation pour les patients. »
« Autrement dit, en plus d’être des cliniciens compétents, ils doivent devenir les chefs d’orchestre de la transformation numérique que connaît notre système de soins de santé. »
Tout un programme… Comment préparer les étudiants à assumer une telle responsabilité ?
« Grâce à un enseignement méthodologique, qui a le mérite de plonger les étudiants au cœur de l’IA pour en découvrir les avantages et les limites. Il est essentiel de comprendre ces contraintes. Je ne parle pas ici des mises en garde classiques qui font la une des médias, mais bien des limites en termes de performance des modèles, des biais inhérents aux données, ainsi que des concepts tels que la transparence algorithmique ou encore les considérations légales, éthiques et déontologiques. »
« Les étudiants apprennent à comprendre l’importance d’ensembles de données diversifiés et inclusifs dans le développement d’outils d’IA. »
« En analysant minutieusement ces limites, nous incitons les étudiants à adopter un regard critique et un réflexe d’innovation : comment surmonter les défis ? Les étudiants apprennent par exemple à identifier les biais dans les données de formation et à comprendre l’importance d’ensembles de données diversifiés et inclusifs dans le développement d’outils d’IA efficaces. Cette expérience leur servira dans le cadre de leurs futures fonctions, quelles qu’elles soient. »
Quels rôles envisagez-vous pour les médecins à l’avenir ?

« D’après moi, l’un des rôles clés sera celui de “traducteur” entre les communautés médicales et technologiques. Une formation en IA sera un énorme atout pour les médecins et les autres prestataires de soins. Pourquoi ? Car ils connaîtront les besoins et les contraintes cliniques et pourront les “traduire” à l’intention des technologues, afin que ceux-ci puissent développer des outils adaptés au contexte clinique. »
« À l’inverse, ils comprendront le fonctionnement de l’IA et sauront ce que permettent ou non les outils d’IA. En partageant ces connaissances, ils feront en sorte que leurs confrères médecins et les autres prestataires de soins non formés ou moins formés à l’IA aient des attentes réalistes et puissent prendre des décisions éclairées. »
« En associant des connaissances médicales et technologiques, les futurs médecins joueront un rôle crucial pour les décideurs politiques. »
« Ils pourront jouer ce même rôle de lien avec le monde politique. En associant leur formation médicale à des connaissances approfondies de l’IA, ils constitueront un interlocuteur idéal pour les décideurs politiques. Ils pourront par exemple apporter un point de vue précieux sur la confidentialité des données de santé, la performance des algorithmes, la transparence algorithmique… en veillant ainsi à ce que le déploiement de l’IA soit fondé sur les réalités cliniques et centré sur le patient. »