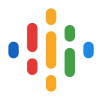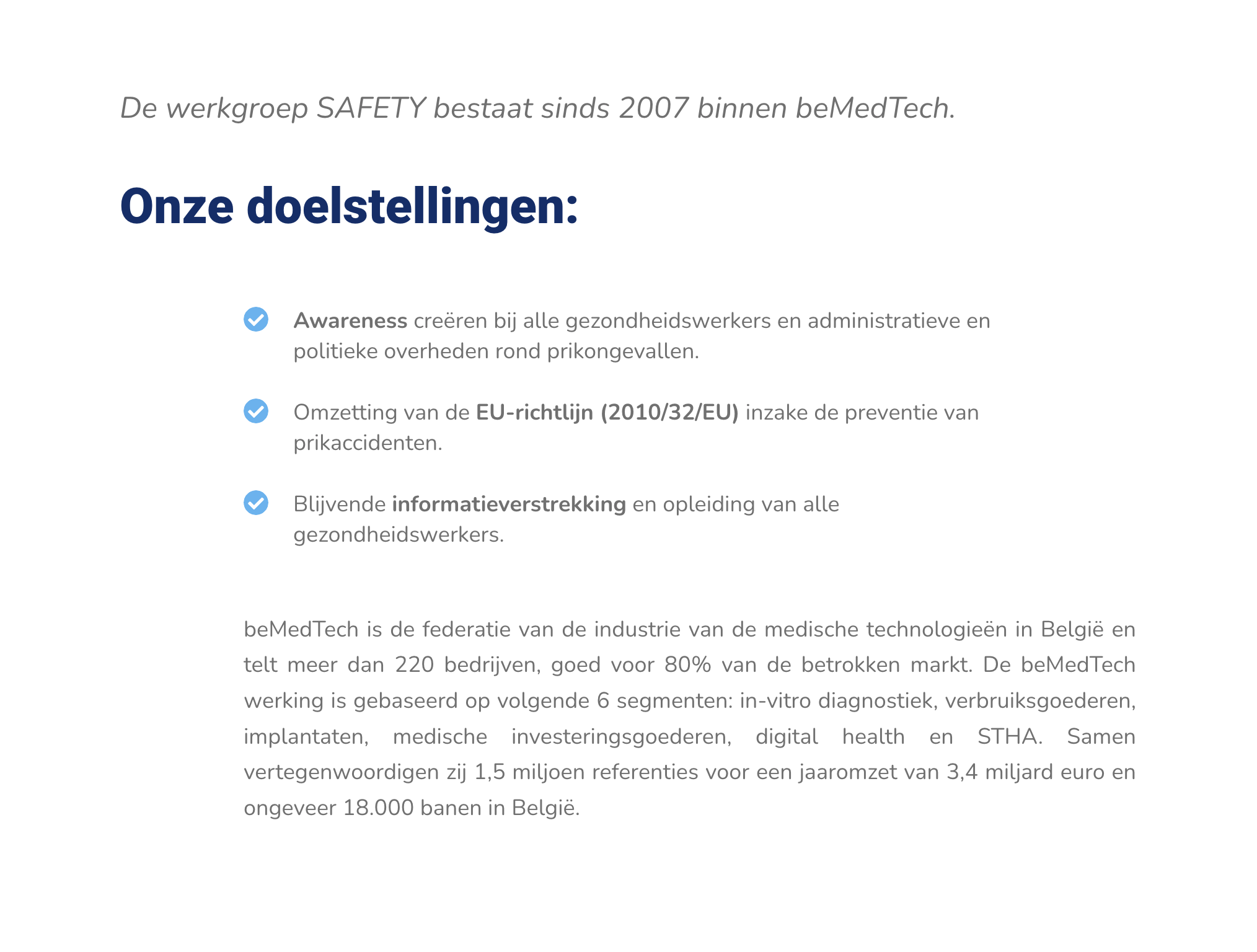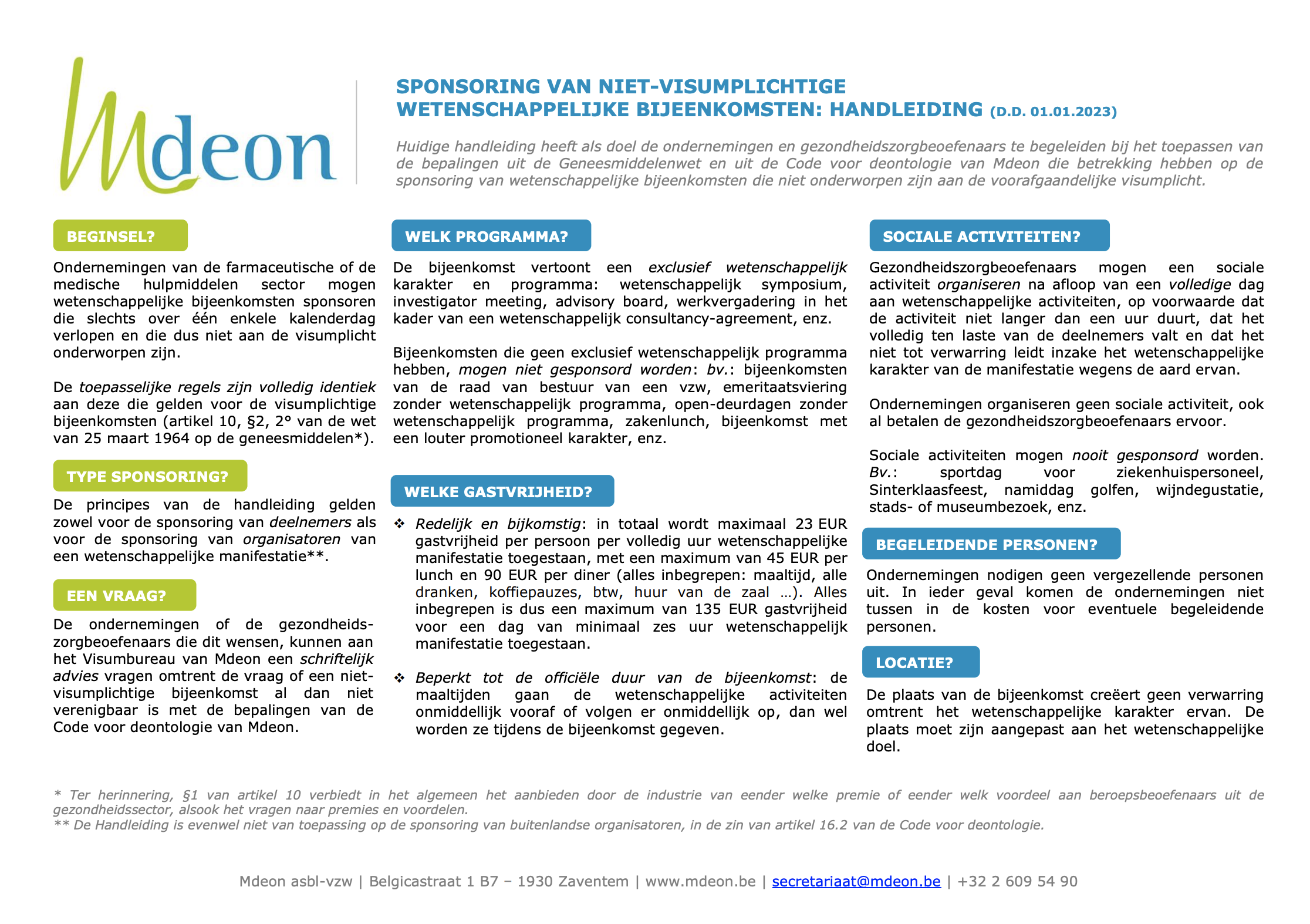Actualités et publications
Grâce à notre salle de presse, nous partageons régulièrement des mises à jour sur les technologies médicales, les évolutions politiques pertinentes et des publications intéressantes. Vous restez ainsi informé d’un secteur en constante évolution.

Le KCE sur la santé numérique: qui n’avance pas recule
Le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) a publié en début d’année son rapport sur l’évaluation des applications numériques médicales en vue de leur financement. Le message à retenir ? Il est encore trop tôt pour arrêter un choix sur telle ou telle méthode, mais il n’est plus question d’attendre. Les technologies numériques médicales évoluent si vite et offrent tellement d’opportunités pour les patients, les prestataires de soins et le système que nous ne pouvons pas nous permettre de prendre du retard.
Les technologies numériques médicales, également appelées « digital medtechs », désignent les applications logicielles déployées à des fins médicales. Ces solutions permettent de collecter, de suivre et de partager des informations de santé, par exemple pour étayer les diagnostics, le suivi et les thérapies.
Les digital medtechs peuvent être subdivisées en plusieurs catégories. beMedTech utilise actuellement trois sous-catégories : la santé mobile ou « m-health », les systèmes d’aide aux décisions cliniques ou « systèmes CDS » et les thérapies numériques ou « DTx ».
Le rapport du Centre fédéral d’expertise des soins de santé n’a pas été publié au hasard. Depuis 2018, nous menons avec la plateforme mHealthBelgium, propulsée par beMedTech, une initiative publique-privée pour l’évaluation et le financement des applications médicales en Belgique.
La « pyramide de validation » de mHealthBelgium se concentre sur la santé mobile (m-health), mais peut également servir à évaluer les thérapies numériques (DTx) et les systèmes d’aide aux décisions cliniques (systèmes CDS). Les DTx peuvent même être financées selon les mêmes principes que la m-health. (Le financement des systèmes CDS est différent, car lié à la réforme de la nomenclature et à l’évolution du financement des hôpitaux au regard des groupes de diagnostic.)
Théorie contre pratique
La Belgique s’est à l’époque imposée en véritable pionnière en proposant la pyramide de validation pour la m-health. Nous avons reçu beaucoup d’éloges internationaux et plusieurs pays se sont inspirés de nous. Cinq ans plus tard, le bilan de mHealthBelgium se révèle cependant (trop) maigre.
36 applications médicales arborent actuellement un label de qualité. Quatre d’entre elles ont déjà démontré leur valeur ajoutée sur le plan économique de la santé et remplissent donc les conditions de financement. Pourtant, aucune de ces quatre applications ne peut compter sur un financement structurel (une seule bénéficie d’un financement provisoire).
Pourquoi ? Le gouvernement souhaite (à juste titre) intégrer l’utilisation des applications médicales dans des programmes de soins plus larges. En l’absence de régime financier pour ces programmes de soins, les applications concernées restent dans la salle d’attente. L’une d’entre elles attend déjà depuis un an et demi.
Le modèle est parfait en théorie, mais quelque chose bloque dans la pratique. Les chiffres le montrent clairement. Notre pyramide autrefois vantée s’apparente de plus en plus à un goulot d’étranglement.
Nous ne sommes pas les seuls à estimer que cette situation ne peut plus durer : les pouvoirs publics sont du même avis. L’INAMI a donc chargé le KCE de passer au crible l’évaluation de la m-health et, plus largement, des technologies numériques médicales. Quels sont les points positifs ? Où le bât blesse-t-il ? Comment faire en sorte que notre modèle théorique solide produise ses effets ? Et que pouvons-nous apprendre des autres pays ?
Six pays européens
Aux fins de son analyse, le KCE a examiné ce qui se faisait dans d’autres pays qui disposent (aussi) d’un modèle d’évaluation pour les technologies numériques médicales, qu’il soit ou non lié au financement. Les pays étudiés sont l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Finlande, l’Autriche et le Royaume-Uni. Le Centre d’expertise s’est également entretenu avec diverses parties prenantes du secteur belge des soins de santé, dont beMedTech.
Constat important, mais relativement évident : les cadres d’évaluation diffèrent considérablement entre les pays. Le contraire aurait été étonnant dans un domaine aussi récent et dynamique que les digital medtechs. Compte tenu de ces disparités, associées à la complexité des systèmes de santé nationaux, les cadres ne peuvent pas être simplement comparés et encore moins copiés d’un pays à l’autre.
Résumé des principaux avis
- Pas de copier-coller: ne vous contentez pas d’imiter les cadres d’autres pays, mais reprenez les éléments qui correspondent le mieux à notre système de santé. On épinglera notamment dans le modèle français la liberté thérapeutique des prestataires de soins (voir ci-dessous) et la vision selon laquelle les digital medtechs ne peuvent pas être utilisées sans concertation entre le prestataire de soins et le patient.
- Politique proactive : en tant que pouvoir public, n’attendez pas que les digital medtechs viennent à vous : osez indiquer de manière proactive les domaines dans lesquels les technologies numériques médicales sont prioritaires. Permettez également à des organisations autres que des entreprises de soumettre un dossier, par exemple des associations de patients ou des mutuelles.
- Liberté thérapeutique : délimitez un cadre clair, mais osez octroyer aux prestataires et institutions de soins qui y évoluent la liberté d’utiliser ou non telle ou telle technologie. À condition, bien sûr, de disposer de connaissances suffisantes des digital medtechs, afin de pouvoir faire des choix éclairés.
- Offre globale : les soins de santé relèvent d’un travail d’équipe. Une équipe dont la technologie fait aujourd’hui partie. Intégrez donc l’utilisation de la technologie dans une offre globale, par exemple par le biais de paiements groupés.
- Évaluation transparente : misez davantage sur la clarté et la transparence des procédures d’évaluation actuelles, notamment les procédures de financement. Les entreprises doivent savoir à l’avance combien de temps durera une procédure et quels critères seront utilisés.
Pas de temps à perdre
La diversité inhérente à un secteur émergent ne doit toutefois pas empêcher les pouvoirs publics d’adopter les digital medtechs (et c’est là que réside le principal risque, selon le KCE). Une attitude attentiste pourrait bien nous faire accuser un retard irrémédiable, dont tout le monde sortirait perdant : les patients, les prestataires de soins, les entreprises et le secteur des soins de santé au sens large.
Le Centre d’expertise envoie ainsi un message clair aux décideurs politiques : n’essayez pas de concevoir un modèle parfait sur le papier, car vous n’aboutirez jamais. Donnez plutôt dès à présent aux applications et autres technologies numériques médicales l’accès au financement, afin que patients et prestataires de soins puissent en profiter. Nous pourrons en effet ajuster et améliorer progressivement le système sur la base de ces expériences pratiques et des enseignements tirés d’autres pays.
- Téléchargez le rapport complet (en anglais) du Centre fédéral d’expertise des soins de santé.
- Téléchargez la synthèse en français ou en néerlandais.

« Besoin d’une vision davantage axée sur l’économie de la santé »
« 35 milliards d’euros de budget de santé, mais très peu de contrôle », titrait le Standaard il y a peu. Si cet article est paru le jour de la Saint-Valentin, il était pourtant loin de la déclaration d’amour à la manière dont la Belgique gère son budget de santé.
L’essence des propos des journalistes du Standaard ? Tandis que nous investissons chaque année des sommes colossales dans les soins de santé (35 milliards d’euros rien qu’au niveau fédéral), les décideurs politiques n’ont pratiquement rien à dire sur l’affectation de ces ressources.
Les décisions relatives à la répartition de ce budget sont prises au sein d’organes consultatifs de l’INAMI, par des représentants des prestataires de soins et des caisses d’assurance maladie. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces organes ne sont pas des modèles de transparence.
Quantité ≠ qualité
Nous faisons donc face à un problème de taille : le montant des impôts que nous consacrons à la santé est certes déterminant, mais la manière dont nous dépensons cet argent est au moins tout aussi importante.
Dans un monde idéal, il s’agirait de réfléchir à la manière d’optimiser chaque euro investi au profit de la santé et de la qualité de vie du patient. En d’autres termes, comment exploiter au mieux ce budget de santé d’un point de vue économique ? Nous sommes néanmoins très loin de ce scénario idéal.
Le modèle de concertation actuel encourage surtout le statu quo.
Le modèle de concertation actuel encourage surtout le statu quo… et c’est tout à fait logique ! Placez un gâteau sur la table, réunissez un groupe de personnes autour de ce gâteau et demandez-leur de se répartir les morceaux. Penseraient-elles aux absents qui méritent également une part ? S’attribueraient-elles une plus petite part pour que d’autres puissent manger plus ? Admettraient-elles que leur rôle est moins important et donc qu’elles ont droit à moins ?
Statu quo
Dans un tel cas de figure, chacun défend automatiquement ses intérêts, en l’occurrence sa part du gâteau. Cette approche a porté ses fruits pendant de longues années, mais tout porte à croire qu’elle atteint désormais ses limites. Les soins de santé ont tellement évolué, ces dernières décennies, que la somme des intérêts des personnes assises autour de la table actuellement ne sert plus réellement l’intérêt général.
Tout le monde sait aujourd’hui que nous devons miser davantage sur la prévention, la gestion de la population, les soins de santé proactifs et intégrés, l’hospitalisation et les soins à domicile, le tout dans le cadre d’un modèle de soins hybride. Les décideurs politiques en font d’ailleurs à juste titre une priorité dans leurs projets. Ils ne disposent cependant pas du budget nécessaire (ou suffisant). Celui-ci est toujours réparti dans la même optique « conservatrice » entre les parties traditionnelles.
Conséquence ? Un clivage de plus en plus prononcé dans notre secteur des soins de santé. Tous parlent d’une politique axée sur les objectifs (de soins) de santé, mais les ambitions en restent pour l’instant principalement au stade théorique.
Un optimisme prudent
Si elle n’est pas réjouissante, cette situation n’empêche pas beMedTech de faire preuve d’un optimisme prudent. Pourquoi ?
- De plus en plus de personnes haut placées au sein de l’INAMI, des mutuelles, des syndicats de médecins et d’autres associations de prestataires de soins de santé se manifestent et estiment que cela ne peut plus durer. Ces personnes remuent ciel et terre pour modifier le système de l’intérieur.
- De plus en plus de prestataires de soins de santé sur le terrain (et il s’agit d’un groupe beaucoup plus large que les seuls médecins) regardent au-delà de leur propre activité. Ils estiment que le système actuel entrave les modernisations nécessaires. Ils n’acceptent plus que le changement soit « un peu plus lent » en Belgique. Les patients méritent les meilleurs soins, dès aujourd’hui.
- Les associations de patients sont elles aussi de plus en plus nombreuses à se mobiliser. Elles constatent par exemple que les patients ne bénéficient pas directement des nouvelles pratiques, des technologies innovantes et autres solutions, sous prétexte qu’elles ne « s’intègrent » pas dans le modèle de rémunération actuel. Les patients ne supportent plus cette situation (à juste titre).
- La presse commence à comprendre que notre système de soins de santé est confronté à un problème de taille et s’y attarde davantage, malgré la complexité de cette matière. Cette attention est primordiale, car un changement de système ne va pas sans pression publique.
- La Belgique n’est pas seule dans le cas. Les pouvoirs publics d’autres pays cherchent également des moyens d’organiser les soins de manière plus intégrée et proactive. L’accentuation excessive des soins aigus n’est pas un problème propre à la Belgique. Nous pourrions donc également tirer des enseignements des bonnes (et mauvaises) pratiques étrangères.
Des soins de santé parés pour le futur
En notre qualité de fédération belge de l’industrie des technologies médicales, nous plaidons pour une réforme structurelle du système, mais nous sommes également convaincus que technologies médicales et système de soins tourné vers l’avenir sont indissociables.
Les technologies médicales peuvent contribuer à accélérer la transition nécessaire des soins aigus vers un modèle de soins continus et intégrés, avec des solutions de prévention, de diagnostic, d’hospitalisation et de soins à domicile dans le cadre d’un modèle hybride, de gestion des maladies… et ainsi accroître le rendement économique de notre budget de santé. Autrement dit, offrir aux patients une meilleure santé et une meilleure qualité de vie pour chaque euro investi.
Les technologies médicales méritent-elles donc une plus grosse part du gâteau ? Peut-être. Il nous semble cependant plus judicieux de laisser cette décision à d’autres. Serait-il temps d’inviter des économistes de la santé indépendants à la table du modèle de concertation ?

Santé numérique : il est grand temps d'accélérer
Le potentiel de la santé numérique pour améliorer nos soins de santé est énorme. Mais l'or ne s'extrait pas tout seul. Quiconque regarde autour de lui constate que les applications numériques ne font que lentement leur chemin dans la pratique. "Il est grand temps d'apprendre à penser différemment dans le domaine des soins de santé", déclare Steven Vandeput de beMedTech. "Car le patient mérite mieux".
Dématérialisation
Le scénario décrit ci-dessus illustre ce qu’on appelle la dématérialisation de la prescription médicale, grâce à laquelle les patients qui le souhaitent peuvent aujourd’hui retirer leurs médicaments à la pharmacie sans support papier. Ils peuvent également gérer eux-mêmes leurs prescriptions en ligne via l’un des canaux patients disponibles.
Les médecins et les pharmaciens, de leur côté, ont moins de paperasse à traiter et donc plus de temps à consacrer aux soins et aux conseils. Grâce à une vue d’ensemble numérique de toutes les prescriptions, ils peuvent en outre offrir un meilleur accompagnement à leurs patients.
Hourra, la santé numérique est arrivée dans notre pays ? Oui… mais aussi non. Certains processus du système de santé, comme toute la gestion des prescriptions, ont déjà été numérisés de manière intelligente. C’est effectivement un pas en avant. Mais il reste encore beaucoup à faire, tant en matière de résultats de soins qu’en ce qui concerne le parcours pour y parvenir.
« Mieux » et « mieux » ne veulent pas toujours dire la même chose
Prenons le résultat attendu de l’exemple précédent : « mieux ». Mais que signifie « mieux » ?
Dans une vision binaire de la santé, la réponse semble logique : il y a « malade » et « en bonne santé », et « mieux » est synonyme de guérison. Pourtant, dans bien des cas, ce n’est pas aussi tranché. « Mieux » représente souvent un état intermédiaire et peut en outre avoir une signification différente pour le patient et pour le soignant. Sans parler des différences entre patients eux-mêmes.
Regardons à présent le parcours vers ce résultat. Le patient reçoit un traitement médicamenteux et doit en évaluer l’efficacité après deux semaines : succès ou échec. Mais que se passe-t-il s’il se sent déjà « mieux » après cinq jours ? Peut-être que le traitement n’est alors plus nécessaire. Et si, au contraire, son état se dégrade au bout d’une semaine ? Un ajustement intermédiaire pourrait être nécessaire pour éviter toute aggravation.
L’innovation ne s’impose pas d’elle-même
Quelle que soit l’ingéniosité d’une solution, elle ne sera pas adoptée spontanément. Voilà sans doute le plus grand défi actuel : faire entrer l’innovation dans la pratique.
La bonne nouvelle, c’est qu’il existe aujourd’hui plusieurs outils pour mieux y parvenir. Il s’agit notamment de solutions technologiques (applications médicales, plateformes de télésuivi, etc.) qui permettent aux soignants de suivre leurs patients à distance, aux patients de gérer leur thérapie à domicile, et de maintenir une communication continue entre patient et soignant plutôt que limitée aux rendez-vous.
Mais cela concerne également de nouveaux modèles de soins – pensons notamment à la value-based healthcare – qui nous aident à aligner les choix thérapeutiques sur les résultats qui comptent réellement pour le patient, et non sur ce que le secteur des soins pense être important pour lui.
Qu’attendons-nous ?
Ces différents outils permettent d’offrir aux patients une expérience de soins personnalisée. Alors, qu’attendons-nous pour les déployer à grande échelle ?
Encore une fois, le défi majeur est de faire adopter l’innovation dans la pratique. Aussi ingénieuse soit-elle, une solution ne sera jamais spontanément acceptée. Il faut un environnement qui encourage l’usage d’outils innovants, qui laisse aux utilisateurs – patients et professionnels – l’espace nécessaire pour expérimenter de manière réfléchie, et qui mette en place les incitants appropriés pour les solutions apportant une réelle valeur ajoutée aux soins. Aujourd’hui, cet environnement n’existe pas encore en Belgique.
Les limites du système
L’organisation et le financement de notre système de santé reposent encore largement sur les mêmes principes qu’il y a plus d’un demi-siècle, lors de la création de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI). Ses mérites sont considérables, notamment en matière d’accessibilité et d’abordabilité des soins pour tous. Mais le système montre aujourd’hui ses limites : il ne tient pas compte de la diversité des résultats attendus d’un patient à l’autre ; il ne parvient pas à évaluer suffisamment vite l’afflux continu d’innovations thérapeutiques ; il récompense encore trop la quantité plutôt que la qualité ; il laisse trop peu de marge de manœuvre aux soignants et aux institutions pour organiser les soins selon les besoins réels des patients.
Des signaux d’espoir
Il existe cependant des signaux encourageants. Ainsi, il a récemment été décidé de rembourser pour la première fois en Belgique une application médicale comme un élément à part entière d’un traitement. La value-based healthcare et la santé numérique figurent désormais en haut de l’agenda politique. De plus, de plus en plus de professionnels de santé, d’institutions de recherche et d’entreprises unissent leurs forces pour innover ensemble.
Il est temps maintenant de passer à la vitesse supérieure, afin d’offrir aux patients les soins qu’ils méritent vraiment.