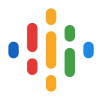Actualités et publications
Grâce à notre salle de presse, nous partageons régulièrement des mises à jour sur les technologies médicales, les évolutions politiques pertinentes et des publications intéressantes. Vous restez ainsi informé d’un secteur en constante évolution.
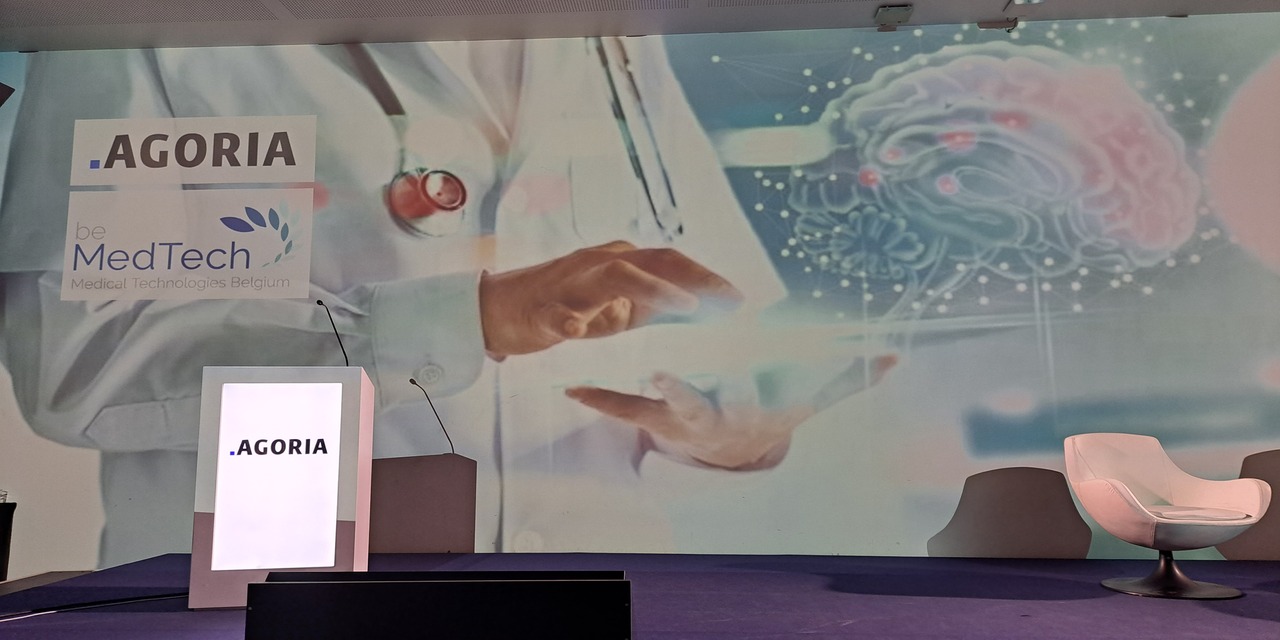
Health Tech Summit, une belle réussite
Agoria et beMedTech ont uni leur force pour organiser le Health Tech Summit ce lundi 19 juin. Un beau beau moment d’échange entre les représentants de l’industrie, les professionnels de soin de santé, les assurances de santé publique mais aussi les autorités et partis politiques. Retour sur cette journée.
Une salle comble. Des représentants de l'industrie. Des politiques. Des débats animés. Bref, une journée réussie.
Si vous n'y étiez pas, voici les quatre points clés à retenir, nous y avons :
- discuté de l'état actuel de l'innovation dans les soins de santé
- réfléchi à la manière dont les choix politiques stratégiques peuvent nous aider à relever les défis croissants.
- démontré, à travers des cas concrets d'utilisation par des professionnels de la santé, comment les innovations dans le domaine de la santé et des technologies médicales soutiennent les soins de santé d'aujourd'hui et de demain.
- présenté en avant-première exclusive sur les messages clés du mémorandum beMedTech

Il y a des défis à reveler, mais nous sommes prêts à le faire. Ensemble.

Il est grand temps de donner un coup de pouce à la technologie
« Les prestataires de soins de santé subissent aujourd’hui une pression énorme, mais la technologie résoudra tous leurs problèmes. »
Soupir... Les revoilà, les gourous de l’innovation. Il faut bien admettre qu’ils sont convaincants. Et honnêtement, nous aimerions y croire. Logique : l’idée d’un avenir radieux apporte une certaine sérénité. Mais n’est-il pas temps qu’après des années de techno-optimisme, nous voyions enfin des avancées dans la pratique ? À partir de quand un optimisme béat devient-il de la naïveté ?
Il y a de fortes chances que de nombreux professionnels de la santé se reconnaissent dans ce scepticisme. « L’innovation technologique » s’apparente de plus en plus à un débat entre croyants et non-croyants. Comment en sommes-nous arrivés là ? Et que faire contre cette polarisation malsaine ?
Comme toujours en matière d’innovation, il y a les innovateurs et les early adopters, ceux qui proposent de nouvelles solutions ou qui sont les premiers à les adopter. Ensemble, ils forment une minorité, ce qui est tout à fait normal.
C’est par la suite que les choses tournent mal. Traditionnellement, la plupart des gens n’adoptent les solutions innovantes qu’une fois que les innovateurs et les early adopters les ont testées et approuvées. Or, c’est là que le bât blesse dans le domaine des soins de santé : cette « adoption » de masse ne se concrétise pas.
Pourquoi ? Parmi tous les facteurs en jeu, le plus important est sans doute l’absence de répit. Comment un peloton peut-il rejoindre l’échappée si les coureurs qui le composent n’ont pas le temps de s’oxygéner, encore moins de manger et de boire ?
Mille et un problèmes
Il en va de même pour les prestataires de soins de santé, qui sont bombardés de nouveaux outils technologiques. Des solutions qui allègent leur charge de travail, les déchargent de certaines tâches pour qu’ils puissent consacrer plus de temps au patient, les aident à prendre des décisions cliniques ou facilitent la collaboration avec d’autres prestataires de soins de santé…
La bonne nouvelle, c’est que nombre de ces outils tiennent leurs promesses.
Mais les soignants n’ont ni le temps ni le soutien pour s’y familiariser. Ils doivent les utiliser immédiatement. La technologie devient, dès lors, un problème de plus, qui vient s’ajouter aux mille autres problèmes qui se posent à eux.
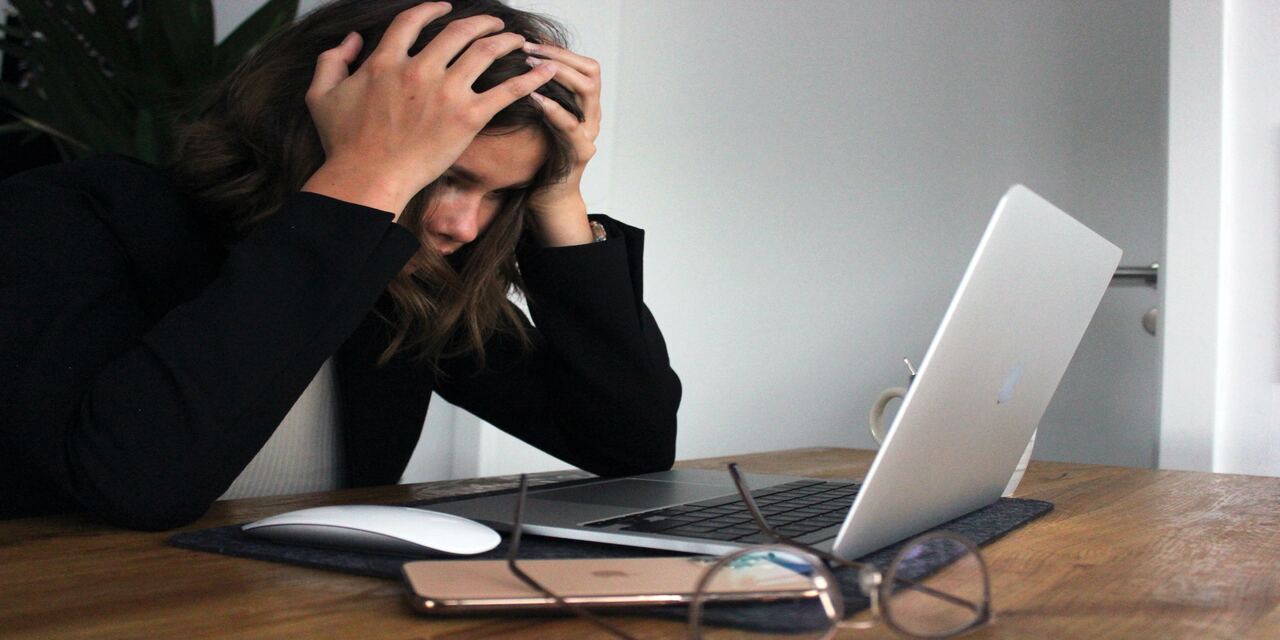
Une bouffée d’oxygène…
Conséquence ? Alors que l’innovation devrait leur apporter une bouffée d’oxygène, elle coupe aujourd’hui le souffle à de nombreux prestataires de soins de santé... Ils perdent lentement mais sûrement confiance dans les possibilités offertes par l’innovation technologique. Honnêtement, qui ne réagirait pas comme eux ? De nombreux outils innovants ne sont donc pas utilisés (correctement). L’impact positif promis sur les soins manque cruellement à l’appel. Ce qui, pour beaucoup, confirme que le techno-optimisme est un rêve qu’il vaut mieux ranger au placard.
Pour le bien-être de nos prestataires de soins, la santé des patients et des citoyens et l’avenir de notre système de santé, il est essentiel de briser cette spirale négative.
Comment ? En donnant aux prestataires de soins de santé le temps et le soutien nécessaires pour apprendre à travailler avec les nouvelles applications. En leur donnant une orientation et un cadre suffisants grâce à des priorités politiques claires. Et en développant de nouvelles applications non pas sans le concours des soignants, mais avec eux.
Yes, we can. .


Augmentation de plus d'un quart de million de blessures par piqûre d'aiguille en Europe
De mars 2020 à mars 2021, plus de 1,46 million d'accidents par piqûre d'aiguille ou coupure ont été recensés dans les établissements de soins de santé de l'Union européenne. Cela représente une augmentation de 22 % par rapport à l'année précédente. Afin d'attirer l'attention sur l'importance de la sécurité dans les établissements de soins de santé, nous lançons, avec nos membres, la campagne de sensibilisation SAFETY.
Marnix Denys, directeur général de beMedTech:
« Ce n'est pas un hasard si nous lançons cette campagne à la veille de la Journée internationale des infirmières. Les infirmières sont plus que jamais sous pression. Un environnement de travail sûr est donc d'autant plus important, tant pour leur santé et leur bien-être que pour ceux de leurs patients. Avec nos membres, nous appelons donc à une politique de sécurité proactive » .
Plus d'un sur deux en Belgique
Une enquête menée par KU Leuven auprès d'infirmières et de techniciens de laboratoire médical en Belgique montre clairement que les accidents de piqûre et de coupure sont fréquents dans notre pays. Pas moins de 55 % des personnes interrogées ont signalé au moins un accident de ce type au cours de leur carrière.
En outre, la plupart des accidents se sont produits dans la chambre du patient. Si cela arrive à un patient atteint d'une maladie infectieuse (par exemple, l'hépatite B, l'hépatite C, le VIH/SIDA), l'infirmière court un risque élevé d'être elle-même infectée.
Moins sûr qu'aux Pays-Bas
Les causes des accidents de coupure et de piqûre sont diverses.
L'un des principaux problèmes est que, souvent, les prestataires de soins de santé belges n'utilisent pas le matériel le plus sûr qui soit. Par exemple, une aiguille sûre n'est utilisée que dans 15 % des injections, contre 45,5 % aux Pays-Bas. Pour les prélèvements sanguins, à peine 11 % des aiguilles utilisées en Belgique sont sûres, contre 86 % aux Pays-Bas. Quant aux cathéters intraveineux, 87 % d'entre eux sont sûrs aux Pays-Bas, contre 55 % en Belgique.
L'un des principaux problèmes est que, souvent, les prestataires de soins de santé belges n'utilisent pas le matériel le plus sûr qui soit.
Pourtant, les établissements de soins de santé font clairement des efforts pour prévenir les accidents dus aux aiguilles et aux coupures. Par exemple, de nombreuses organisations mettent en place des procédures internes en cas d'accident, des campagnes auprès du personnel sur l'importance de la sécurité et des formations à la sécurité. Toutefois, la mise en place et le maintien d'une telle politique de sécurité interne nécessitent un investissement continu en temps et en ressources. Et c'est un aspect qui fait souvent défaut aux organisations de soins de santé.
SAFETY : cinq messages clairs
Avec la campagne SAFETY, nous appelons tous les acteurs du secteur des soins de santé à travailler ensemble pour accorder plus d'attention à la sécurité des travailleurs du secteur des soins de santé. Pour ce faire, la fédération met en avant cinq points clés :
- Amélioration de la notification et du suivi : les accidents liés aux piqûres et aux coupures ne sont souvent pas signalés. On estime que 40 à 75 % des accidents de piqûre et de coupure ne sont pas signalés. L'enregistrement obligatoire dans un registre central permettrait aux décideurs politiques d'avoir une meilleure vue d'ensemble du problème et de prendre des mesures ciblées.
- Utilisation accrue d'équipements sûrs : les équipements sûrs réduisent considérablement le risque d'accidents par piqûre ou coupure, mais dans la pratique, les équipements équipés de systèmes de sécurité restent très peu utilisés en Belgique. Souvent parce qu'ils coûtent plus cher que les alternatives conventionnelles.
- Budget de sécurité pour les institutions de soins : l'élaboration et le maintien d'une bonne politique de sécurité coûtent de l'argent, un argent qui fait défaut à de nombreuses institutions de soins. Grâce à des mesures ciblées, les pouvoirs publics peuvent donner aux établissements de soins la marge de manœuvre financière nécessaire pour investir davantage dans la sécurité.
- Formation et sensibilisation : plus de la moitié des infirmières souhaitent davantage de formation sur les accidents liés aux aiguilles et aux coupures. La recherche montre également que le risque de tels accidents est considérablement réduit lorsque les prestataires de soins de santé sont bien formés. Outre la formation, la sensibilisation est également importante. La création d'un environnement de travail sûr exige un certain état d'esprit qu'il convient de développer en permanence.
- Un cadre juridique contraignant et une meilleure supervision : la législation actuelle est sujette à interprétation, de sorte que son application peut varier considérablement d'un établissement de soins à l'autre. Un cadre juridique clair et contraignant s'impose, associé à une meilleure application.


Toutes les informations de la campagne sont à retrouver ici.

Les patients français devront bientôt attendre moins longtemps pour bénéficier d'une technologie médicale numérique prometteuse
Le PECAN est bon pour la santé. Nous ne parlons pas de la noix de pécan, mais d'un nouveau décret français visant à accélérer l'accès des patients à la technologie médicale numérique : "Prise en charge anticipée (des dispositifs médicaux) numérique" ou PECAN.
Avec le décret PECAN de fin mars 2023, le gouvernement français vise à mettre les technologies médicales numériques prometteuses plus rapidement à la disposition des citoyens. Plus précisément, il s'agit de technologies qui peuvent être utilisées pendant le traitement des patients ou pour les surveiller à distance.
Pourquoi le décret PECAN est-il nécessaire ?
Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que les technologies médicales numériques peuvent apporter une valeur ajoutée significative aux patients/citoyens, aux prestataires de soins de santé et au système de santé. Dans le même temps, les gouvernements du monde entier s'efforcent à donner à ces technologies une place structurelle dans leur système de soins de santé.
Les procédures d'approbation de nouveaux modèles de traitement ou d'organisation des soins sont traditionnellement longues. Le temps qu'une nouvelle demande soit évaluée et financée, il peut souvent y avoir des mois, voire des années, qui se sont écoulés. Cette lenteur contraste fortement avec l'évolution rapide des technologies médicales. Elle crée une impasse douloureuse : de nombreux patients pourraient être mieux soignés grâce à des technologies médicales qui existent déjà, mais en sont privés pour des raisons de procédure... Le gouvernement français a estimé que cela ne pouvait plus durer !


Comment les technologies médicales numériques vont-elles atteindre plus rapidement les citoyens français ?
En France, les médecins pourront prescrire des technologies médicales numériques à leurs patients avant même qu'elles n'aient effectué toutes les procédures. L'assurance maladie prendra en charge le coût de cette prescription.
Pour bénéficier de ce remboursement accéléré, les entreprises doivent inscrire leur technologie et l'application doit répondre à certaines conditions de sécurité de base. Au cours de l'année, l'entreprise doit également collecter suffisamment de données pour l'évaluation clinique de la technologie. Si la valeur ajoutée clinique est démontrée, le financement structurel suit.
718 millions d'euros pour l'accélération numérique de la santé en France
En 2021, la France a lancé le programme « France 2030 ». Un élément clé de ce programme : Innovation santé 2030, un programme visant à faire de la France le premier pays d'Europe en matière d'innovation dans le domaine de la santé et des soins.
La réalisation d'une telle ambition n'est évidemment pas une mince affaire. Le gouvernement français consacre pas moins de 7,5 milliards d'euros à « Innovation santé 2030 », sur une période de cinq ans. Sur ces 7,5 milliards, 718 millions d'euros seront consacrés à l'accélération numérique des soins de santé en France. Le décret PECAN encadre cette accélération numérique.

Et la Belgique ?
La Belgique dispose d'un grand savoir-faire en matière de technologie médicale numérique. En 2018, nous avons également été l'un des premiers pays au monde à introduire un modèle de validation pour la mobile health (une catégorie de technologie médicale numérique), la « pyramide de validation » de mHealthBelgium. Plusieurs pays se sont ensuite inspirés du modèle belge.
Les applications qui atteignent le sommet de la pyramide peuvent compter sur un financement de l’INAMI. Mais plus de cinq ans après l'introduction du modèle, on ne compte qu’une seule application financée, moveUp, qui plus est de manière conditionnelle. Cela montre que la Belgique a également du mal à mettre en œuvre les technologies médicales numériques.
Au début de cette année, le Centre fédéral d’expertise des soins de santé a publié un rapport sur l'évaluation et le financement des applications médicales numériques (pour en savoir plus, cliquer ICI). Ce rapport contient une série de recommandations précieuses pour les décideurs politiques afin d'accélérer la mise en œuvre des technologies médicales numériques. Avec beMedTech, nous conseillons aussi régulièrement le gouvernement à ce sujet.
Notre objectif ? Contribuer à accélérer la digital health en Belgique. Si cela nous permet de figurer sur une liste des « meilleurs systèmes de soins de santé numériques en Europe », ce n’est que du bonus. Mais ce qui compte, c'est que les patients reçoivent plus rapidement les meilleurs soins possibles.

Oser et agir : la clé pour activer les technologies numériques médicales
La publication, plus tôt cette année, du rapport sur l’évaluation des technologies numériques médicales du Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) nous avait laissé un sentiment mitigé. Nous étions largement satisfaits de l’analyse approfondie et des recommandations du KCE, mais un peu moins de l’inertie du côté politique. Comme si le potentiel des Digital MedTechs restait à prouver… De récents entretiens avec les décideurs politiques nous redonnent espoir. Mais comme le dit le vieil adage, on juge toujours le maçon au pied du mur.
Cher Steven, beMedTech prône-t-elle un remboursement de l’utilisation de certaines apps médicales par l’assurance maladie ? Oui, vous avez bien lu ! C’est la question que nous a posée un journaliste en janvier dernier, dans la foulée de la publication du rapport du KCE.
Retour en arrière
Remontons le temps jusqu’en 2016, à l’époque du coup d’envoi de 24 projets pilotes consacrés à la santé mobile, également appelée « m-health ». La m-health était alors un sujet relativement récent dans le paysage international des soins de santé. Nous étions tous excités à l’idée que les patients et les prestataires de soins belges commencent à utiliser des apps médicales au quotidien.
Lorsqu’il s’est avéré que l’utilisation d’apps pouvait apporter une valeur ajoutée dans de nombreuses situations, une question a logiquement suivi : à quand le financement des apps médicales par l’INAMI ? Au moins un journaliste nous a posé cette question à raison d’une fois par mois pendant deux à trois ans. Chaque fois, nous devions nous résoudre à répondre que beMedTech se posait la même question.
Appuyons à présent sur « avance rapide » pour revenir en janvier 2023. Plus de six (!) ans après le lancement des projets pilotes de m-health, on nous demande si nous sommes favorables à un financement officiel par l’INAMI de certaines apps médicales… Comme si le temps s’était figé pendant toutes ces années !


Apprendre à patiner
Le journaliste n’est bien sûr pas à blâmer. Sa question met toutefois en lumière un problème sous-jacent dans notre système de soins de santé. Dans les domaines où nous bénéficions d’une assise solide, nous osons à juste titre expérimenter des moyens d’apporter plus rapidement l’innovation aux patients et aux prestataires de soins. Citons, par exemple, les procédures d’accès anticipé et rapide à de nouveaux médicaments prometteurs. En revanche, lorsque nous évoluons en terrain glissant, nous nous cramponnons à la rambarde. Ce qui n’est pas nécessairement la meilleure stratégie pour apprendre à patiner.
De nombreuses applications de santé numériques ont pourtant déjà largement démontré leur valeur ajoutée. Dans le domaine de la santé mobile, mais aussi dans le domaine des thérapies numériques et des systèmes d’aide aux décisions cliniques (cliquez ICI pour en savoir plus sur ces trois domaines). Plusieurs pays encouragent déjà leur utilisation, mais pas la Belgique. Malgré un score brillant à l’examen théorique, avec notre pyramide de validation pour la m-health qui nous a valu le statut de pionnier international, nous avons pris la fâcheuse habitude de repousser sans cesse la date de l’examen pratique.
Input, output
Comment l’expliquer ? L’une des principales causes réside dans « le système ». Le financement des soins de santé se concentre principalement sur le début et la fin du programme de soins : quels soins administrons-nous et qu’apportent-ils au patient ? Nous payons pour un input qui améliore l’état de santé du patient.
Les technologies numériques médicales, en revanche, et a fortiori la m-health avec ses applications de télésurveillance, interviennent souvent dans le processus qui se situe entre l’input et l’output. Ces solutions aident les prestataires de soins et les patients à mieux communiquer entre eux, elles fournissent aux prestataires de soins des données qui leur donnent un meilleur aperçu de l’évolution d’une maladie, elles aident les patients à suivre leur traitement avec plus d’assiduité et de précision, etc. Elles ont ainsi un impact positif considérable sur l’output. Notre formule de financement actuelle ne laisse cependant pas de place à l’amélioration de processus ou à des soins plus personnalisés…
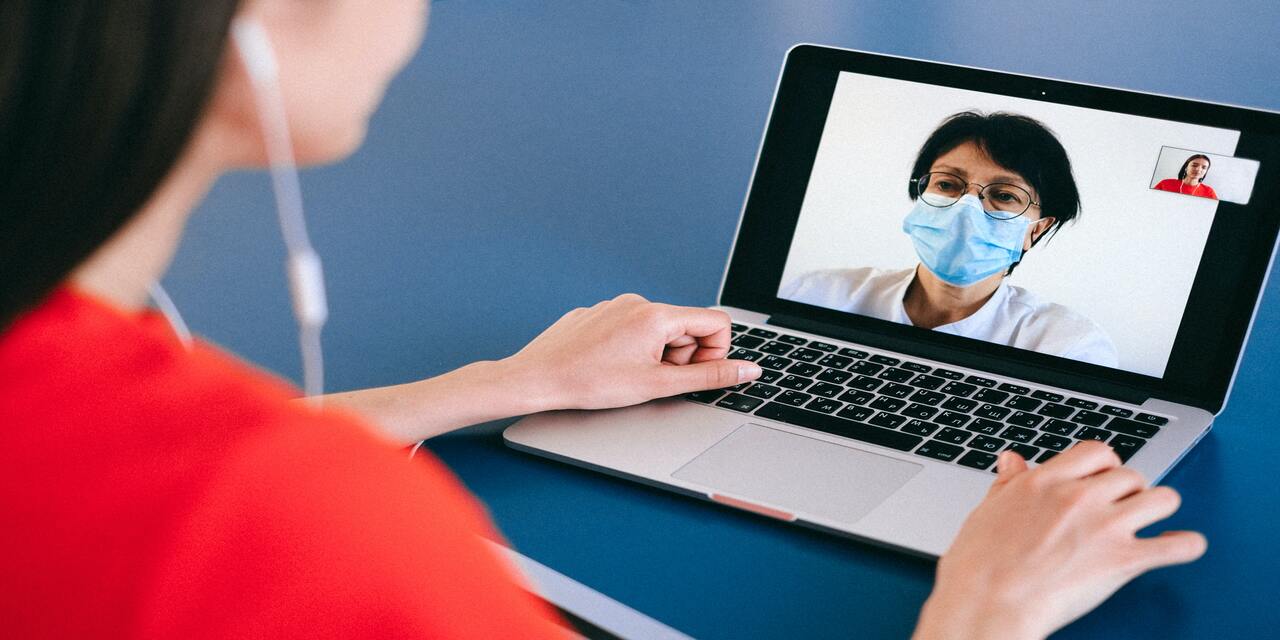

Sauter le pas
Nous sommes de plus en plus nombreux à réaliser que nous passons à côté d’opportunités colossales en ne tenant compte que du début et de la fin du programme de soins. Pour améliorer encore l’output pour les patients, nous devons également améliorer les processus intermédiaires. Les Digital MedTechs ont un rôle important à jouer à cet égard.
Le rapport du KCE aidera-t-il les décideurs politiques à sortir de l’impasse actuelle ? C’est possible (en partie), à condition que nous en retirions tous le bon message. Et ce message est non pas que nous devons avant tout nous concentrer sur un cadre d’évaluation totalement neuf (nous avons en effet déjà démontré nos compétences théoriques avec la pyramide de validation) ; mais plutôt que nous devons oser et agir. C’est à l’usage que l’on peut juger de la qualité d’un système. En d’autres termes, l’heure est venue de lâcher la rambarde et de passer à la pratique. Nous pourrons toujours ajuster le cadre théorique en cours de route.
Qu’en pensez-vous ?
Cher Steven, beMedTech prône-t-elle un remboursement de l’utilisation de certaines apps médicales par l’assurance maladie ?
Cher journaliste, vous posez, selon nous, la mauvaise question. Il s’agit avant tout de savoir si les opportunités que recèlent les technologiques numériques médicales valent la peine d’être saisies. Pour nous, la réponse est oui, sans aucune hésitation. Les Digital MedTechs peuvent nous aider à mieux soigner un plus grand nombre de patients et à fournir un encadrement continu aux prestataires de soins. Je vous retourne donc la question : pensez-vous que l’assurance maladie devrait mobiliser des ressources à cet effet ?

Le KCE sur la santé numérique: qui n’avance pas recule
Le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) a publié en début d’année son rapport sur l’évaluation des applications numériques médicales en vue de leur financement. Le message à retenir ? Il est encore trop tôt pour arrêter un choix sur telle ou telle méthode, mais il n’est plus question d’attendre. Les technologies numériques médicales évoluent si vite et offrent tellement d’opportunités pour les patients, les prestataires de soins et le système que nous ne pouvons pas nous permettre de prendre du retard.
Les technologies numériques médicales, également appelées « digital medtechs », désignent les applications logicielles déployées à des fins médicales. Ces solutions permettent de collecter, de suivre et de partager des informations de santé, par exemple pour étayer les diagnostics, le suivi et les thérapies.
Les digital medtechs peuvent être subdivisées en plusieurs catégories. beMedTech utilise actuellement trois sous-catégories : la santé mobile ou « m-health », les systèmes d’aide aux décisions cliniques ou « systèmes CDS » et les thérapies numériques ou « DTx ».
Le rapport du Centre fédéral d’expertise des soins de santé n’a pas été publié au hasard. Depuis 2018, nous menons avec la plateforme mHealthBelgium, propulsée par beMedTech, une initiative publique-privée pour l’évaluation et le financement des applications médicales en Belgique.
La « pyramide de validation » de mHealthBelgium se concentre sur la santé mobile (m-health), mais peut également servir à évaluer les thérapies numériques (DTx) et les systèmes d’aide aux décisions cliniques (systèmes CDS). Les DTx peuvent même être financées selon les mêmes principes que la m-health. (Le financement des systèmes CDS est différent, car lié à la réforme de la nomenclature et à l’évolution du financement des hôpitaux au regard des groupes de diagnostic.)
Théorie contre pratique
La Belgique s’est à l’époque imposée en véritable pionnière en proposant la pyramide de validation pour la m-health. Nous avons reçu beaucoup d’éloges internationaux et plusieurs pays se sont inspirés de nous. Cinq ans plus tard, le bilan de mHealthBelgium se révèle cependant (trop) maigre.
36 applications médicales arborent actuellement un label de qualité. Quatre d’entre elles ont déjà démontré leur valeur ajoutée sur le plan économique de la santé et remplissent donc les conditions de financement. Pourtant, aucune de ces quatre applications ne peut compter sur un financement structurel (une seule bénéficie d’un financement provisoire).
Pourquoi ? Le gouvernement souhaite (à juste titre) intégrer l’utilisation des applications médicales dans des programmes de soins plus larges. En l’absence de régime financier pour ces programmes de soins, les applications concernées restent dans la salle d’attente. L’une d’entre elles attend déjà depuis un an et demi.
Le modèle est parfait en théorie, mais quelque chose bloque dans la pratique. Les chiffres le montrent clairement. Notre pyramide autrefois vantée s’apparente de plus en plus à un goulot d’étranglement.
Nous ne sommes pas les seuls à estimer que cette situation ne peut plus durer : les pouvoirs publics sont du même avis. L’INAMI a donc chargé le KCE de passer au crible l’évaluation de la m-health et, plus largement, des technologies numériques médicales. Quels sont les points positifs ? Où le bât blesse-t-il ? Comment faire en sorte que notre modèle théorique solide produise ses effets ? Et que pouvons-nous apprendre des autres pays ?
Six pays européens
Aux fins de son analyse, le KCE a examiné ce qui se faisait dans d’autres pays qui disposent (aussi) d’un modèle d’évaluation pour les technologies numériques médicales, qu’il soit ou non lié au financement. Les pays étudiés sont l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Finlande, l’Autriche et le Royaume-Uni. Le Centre d’expertise s’est également entretenu avec diverses parties prenantes du secteur belge des soins de santé, dont beMedTech.
Constat important, mais relativement évident : les cadres d’évaluation diffèrent considérablement entre les pays. Le contraire aurait été étonnant dans un domaine aussi récent et dynamique que les digital medtechs. Compte tenu de ces disparités, associées à la complexité des systèmes de santé nationaux, les cadres ne peuvent pas être simplement comparés et encore moins copiés d’un pays à l’autre.
Résumé des principaux avis
- Pas de copier-coller: ne vous contentez pas d’imiter les cadres d’autres pays, mais reprenez les éléments qui correspondent le mieux à notre système de santé. On épinglera notamment dans le modèle français la liberté thérapeutique des prestataires de soins (voir ci-dessous) et la vision selon laquelle les digital medtechs ne peuvent pas être utilisées sans concertation entre le prestataire de soins et le patient.
- Politique proactive : en tant que pouvoir public, n’attendez pas que les digital medtechs viennent à vous : osez indiquer de manière proactive les domaines dans lesquels les technologies numériques médicales sont prioritaires. Permettez également à des organisations autres que des entreprises de soumettre un dossier, par exemple des associations de patients ou des mutuelles.
- Liberté thérapeutique : délimitez un cadre clair, mais osez octroyer aux prestataires et institutions de soins qui y évoluent la liberté d’utiliser ou non telle ou telle technologie. À condition, bien sûr, de disposer de connaissances suffisantes des digital medtechs, afin de pouvoir faire des choix éclairés.
- Offre globale : les soins de santé relèvent d’un travail d’équipe. Une équipe dont la technologie fait aujourd’hui partie. Intégrez donc l’utilisation de la technologie dans une offre globale, par exemple par le biais de paiements groupés.
- Évaluation transparente : misez davantage sur la clarté et la transparence des procédures d’évaluation actuelles, notamment les procédures de financement. Les entreprises doivent savoir à l’avance combien de temps durera une procédure et quels critères seront utilisés.
Pas de temps à perdre
La diversité inhérente à un secteur émergent ne doit toutefois pas empêcher les pouvoirs publics d’adopter les digital medtechs (et c’est là que réside le principal risque, selon le KCE). Une attitude attentiste pourrait bien nous faire accuser un retard irrémédiable, dont tout le monde sortirait perdant : les patients, les prestataires de soins, les entreprises et le secteur des soins de santé au sens large.
Le Centre d’expertise envoie ainsi un message clair aux décideurs politiques : n’essayez pas de concevoir un modèle parfait sur le papier, car vous n’aboutirez jamais. Donnez plutôt dès à présent aux applications et autres technologies numériques médicales l’accès au financement, afin que patients et prestataires de soins puissent en profiter. Nous pourrons en effet ajuster et améliorer progressivement le système sur la base de ces expériences pratiques et des enseignements tirés d’autres pays.
- Téléchargez le rapport complet (en anglais) du Centre fédéral d’expertise des soins de santé.
- Téléchargez la synthèse en français ou en néerlandais.

« Besoin d’une vision davantage axée sur l’économie de la santé »
« 35 milliards d’euros de budget de santé, mais très peu de contrôle », titrait le Standaard il y a peu. Si cet article est paru le jour de la Saint-Valentin, il était pourtant loin de la déclaration d’amour à la manière dont la Belgique gère son budget de santé.
L’essence des propos des journalistes du Standaard ? Tandis que nous investissons chaque année des sommes colossales dans les soins de santé (35 milliards d’euros rien qu’au niveau fédéral), les décideurs politiques n’ont pratiquement rien à dire sur l’affectation de ces ressources.
Les décisions relatives à la répartition de ce budget sont prises au sein d’organes consultatifs de l’INAMI, par des représentants des prestataires de soins et des caisses d’assurance maladie. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces organes ne sont pas des modèles de transparence.
Quantité ≠ qualité
Nous faisons donc face à un problème de taille : le montant des impôts que nous consacrons à la santé est certes déterminant, mais la manière dont nous dépensons cet argent est au moins tout aussi importante.
Dans un monde idéal, il s’agirait de réfléchir à la manière d’optimiser chaque euro investi au profit de la santé et de la qualité de vie du patient. En d’autres termes, comment exploiter au mieux ce budget de santé d’un point de vue économique ? Nous sommes néanmoins très loin de ce scénario idéal.
Le modèle de concertation actuel encourage surtout le statu quo.
Le modèle de concertation actuel encourage surtout le statu quo… et c’est tout à fait logique ! Placez un gâteau sur la table, réunissez un groupe de personnes autour de ce gâteau et demandez-leur de se répartir les morceaux. Penseraient-elles aux absents qui méritent également une part ? S’attribueraient-elles une plus petite part pour que d’autres puissent manger plus ? Admettraient-elles que leur rôle est moins important et donc qu’elles ont droit à moins ?
Statu quo
Dans un tel cas de figure, chacun défend automatiquement ses intérêts, en l’occurrence sa part du gâteau. Cette approche a porté ses fruits pendant de longues années, mais tout porte à croire qu’elle atteint désormais ses limites. Les soins de santé ont tellement évolué, ces dernières décennies, que la somme des intérêts des personnes assises autour de la table actuellement ne sert plus réellement l’intérêt général.
Tout le monde sait aujourd’hui que nous devons miser davantage sur la prévention, la gestion de la population, les soins de santé proactifs et intégrés, l’hospitalisation et les soins à domicile, le tout dans le cadre d’un modèle de soins hybride. Les décideurs politiques en font d’ailleurs à juste titre une priorité dans leurs projets. Ils ne disposent cependant pas du budget nécessaire (ou suffisant). Celui-ci est toujours réparti dans la même optique « conservatrice » entre les parties traditionnelles.
Conséquence ? Un clivage de plus en plus prononcé dans notre secteur des soins de santé. Tous parlent d’une politique axée sur les objectifs (de soins) de santé, mais les ambitions en restent pour l’instant principalement au stade théorique.
Un optimisme prudent
Si elle n’est pas réjouissante, cette situation n’empêche pas beMedTech de faire preuve d’un optimisme prudent. Pourquoi ?
- De plus en plus de personnes haut placées au sein de l’INAMI, des mutuelles, des syndicats de médecins et d’autres associations de prestataires de soins de santé se manifestent et estiment que cela ne peut plus durer. Ces personnes remuent ciel et terre pour modifier le système de l’intérieur.
- De plus en plus de prestataires de soins de santé sur le terrain (et il s’agit d’un groupe beaucoup plus large que les seuls médecins) regardent au-delà de leur propre activité. Ils estiment que le système actuel entrave les modernisations nécessaires. Ils n’acceptent plus que le changement soit « un peu plus lent » en Belgique. Les patients méritent les meilleurs soins, dès aujourd’hui.
- Les associations de patients sont elles aussi de plus en plus nombreuses à se mobiliser. Elles constatent par exemple que les patients ne bénéficient pas directement des nouvelles pratiques, des technologies innovantes et autres solutions, sous prétexte qu’elles ne « s’intègrent » pas dans le modèle de rémunération actuel. Les patients ne supportent plus cette situation (à juste titre).
- La presse commence à comprendre que notre système de soins de santé est confronté à un problème de taille et s’y attarde davantage, malgré la complexité de cette matière. Cette attention est primordiale, car un changement de système ne va pas sans pression publique.
- La Belgique n’est pas seule dans le cas. Les pouvoirs publics d’autres pays cherchent également des moyens d’organiser les soins de manière plus intégrée et proactive. L’accentuation excessive des soins aigus n’est pas un problème propre à la Belgique. Nous pourrions donc également tirer des enseignements des bonnes (et mauvaises) pratiques étrangères.
Des soins de santé parés pour le futur
En notre qualité de fédération belge de l’industrie des technologies médicales, nous plaidons pour une réforme structurelle du système, mais nous sommes également convaincus que technologies médicales et système de soins tourné vers l’avenir sont indissociables.
Les technologies médicales peuvent contribuer à accélérer la transition nécessaire des soins aigus vers un modèle de soins continus et intégrés, avec des solutions de prévention, de diagnostic, d’hospitalisation et de soins à domicile dans le cadre d’un modèle hybride, de gestion des maladies… et ainsi accroître le rendement économique de notre budget de santé. Autrement dit, offrir aux patients une meilleure santé et une meilleure qualité de vie pour chaque euro investi.
Les technologies médicales méritent-elles donc une plus grosse part du gâteau ? Peut-être. Il nous semble cependant plus judicieux de laisser cette décision à d’autres. Serait-il temps d’inviter des économistes de la santé indépendants à la table du modèle de concertation ?